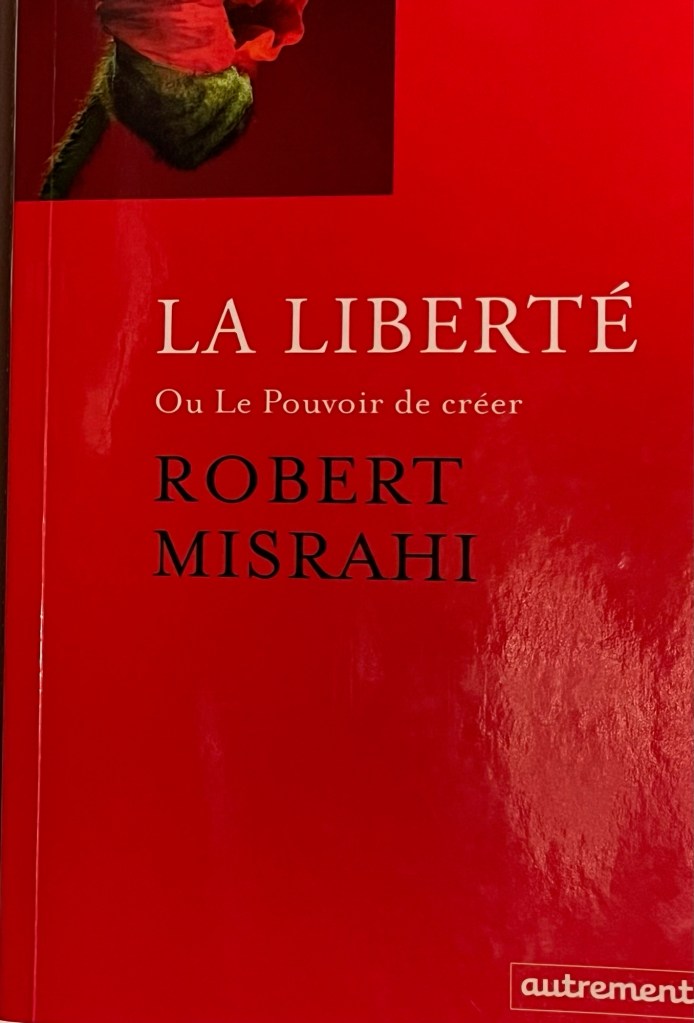[…] comment se fait-il que la liberté (dont nous avons souligné l’indispensable affirmation) soit si souvent refusée dans la culture dominante ? Est-il suffisant d’invoquer comme réponse le refus du risque (comme nous le faisons aussi) ou le refus de l’angoisse (comme le font Sartre ou, parfois, certains analystes) ?
Je ne pense pas avoir rendu entièrement compte de cette fuite généralisée devant la liberté dangereuse. Pourquoi, qu’elle soit spontanée ou réflexive, est-elle si farouchement niée ? Si ardemment méconnue par ceux-là mêmes qui signent leurs œuvres et inventent leur vie ?
Le hors-monde
S’il en est ainsi, peut-être est-ce parce qu’il y a, dans l’idée et dans l’acte de la liberté, des implications que nous n’avons encore ni explicitées ni élucidées.
Partons de l’expérience quotidienne la plus simple et la plus immédiate. Je (moi, vous, il…) perçois un espace que je reconnais : ma chambre, ma rue, mon jardin, mon bureau, ma gare, ma voiture, mon trajet. Il s’agit en effet de ma perception : je perçois un monde qui est le mien et qui existe bien là, devant et autour de moi. Je n’ai pas envie de faire de la métaphysique et d’imaginer que ce monde est une illusion et qu’il n’existe pas. Au contraire, je suis assuré qu’il existe… et là d’ailleurs n’est pas la question.
Je veux plutôt insister sur un fait, impliqué par ma perception elle-même et que chacun (toutes professions confondues) reconnaîtra aisément : ce monde que je perçois a une matérialité et une objectivité faites de différents matériaux, ciments, textiles, métaux, végétaux, matériaux distribués autour de moi. Mais ces matériaux objectifs ont un sens : il s’agit de ma rue, de mon train ou de mon bureau. Pour tout un chacun, le monde qu’il perçoit et qui est son monde a un sens. Or, ce sens est ajouté aux matériaux : des planches de bois, même peintes, ne constituent pas par elles-mêmes une « bibliothèque » ; un plan noir, carré et ressemblant à du verre opaque ne constitue pas par lui-même un écran d’ordinateur; et une grande caisse en métal ne constitue pas par elle-même une motrice de TGV ou une 2CV Citroën. De même pour l’ensemble de ma perception et pour l’ensemble du monde perçu par les humains. La pure matérialité du monde n’en épuise pas et n’en définit donc pas toute la réalité. Pour ce faire, il faut ajouter un regard humain. C’est mon regard (le vôtre, le sien) qui ajoute au matériau une signification : c’est par moi (oui, par moi) que des planches constituent une bibliothèque et qu’une plaque noire constitue un écran d’ordinateur (ou une plaque chauffante). C’est le sens ajouté qui constitue la réalité entière de l’objet que je perçois et que j’utilise. Sa matérialité devient par moi son utilité, et celle-ci suppose d’abord que j’aie en effet donné préalablement un sens (ordinateur, voiture) à cet objet inerte situé dans l’espace de ma perception. C’est la totalité de ma perception qui est ainsi constituée par moi comme monde significatif et utilisable. On reconnaîtra aisément que, ce faisant, je mobilise un savoir venu d’ailleurs : j’ai appris par d’autres ce qu’est un ordinateur ou une plaque chauffante. Mais c’est parce que c’est moi qui ai entendu et compris ce qu’on m’a expliqué. C’est moi qui me suis rendu capable de donner à ces matériaux le sens qu’ils ont et de les constituer en outils. Ce sont toujours des sujets (aussi empiriques soient-ils) qui donnent le sens et qui constituent le monde.
Ce sens peut n’être pas seulement utilitaire, il peut être contemplatif, esthétique. Le sujet, les sujets peuvent ajouter au sens une « valeur ». Le Renoir, la Mercedes prendront non seulement une signification (tableau, voiture), mais encore une valeur, esthétique et marchande.
Cette réflexion pourrait se poursuivre en se déployant dans diverses directions : théorie de la perception, théorie de l’action, théorie de l’art ou de l’économie, éthique, etc.
Ici, mon objet est autre.
Je souhaite tirer non pas toutes les conséquences de ce fait central qu’est la donation de sens, mais seulement la conséquence première. Je souhaite dégager la première et la plus importante des implications de ce fait indiscutable qu’est la donation de sens par l’homme, donation par laquelle seulement un « monde » existe.
Cette implication est le pouvoir constituant du sujet. Celui-ci est constituant par nature.
Qu’il s’agisse du sujet spontané (comme présence à soi et « réflexivité ») ou du sujet réfléchi (comme « réflexion »), c’est toujours un sujet humain qui constitue le sens du monde, c’est-à-dire qui l’invente, le fabrique, l’affirme et le « constate » (ces termes pourraient être analysés longuement). De ce pouvoir constituant on peut tirer comme conséquences l’effectivité de la liberté et l’effectivité des actes de création, et cela toujours sur deux niveaux possibles : la spontanéité produisant librement l’existence empirique et dépendante, la réflexion produisant librement l’existence indépendante et éventuellement heureuse. C’est par la réflexion qu’on passe d’une existence chaotique à une existence harmonieuse.
J’ai affirmé ailleurs le rôle d’une indispensable conversion philosophique dans la construction et la mise en œuvre d’une éthique du bonheur. Ici, je voudrais examiner une autre conséquence fondamentale du fait même de ce pouvoir constituant de la conscience.
Cette conséquence désignons-la d’abord par un terme et son idée : l’antériorité.
La conscience est l’antériorité. Elle est antérieure à toutes les actions de l’être humain puisque c’est elle qui décide de leur surgissement. Si l’on conteste ce pouvoir de l’initiative, on sera au moins contraint d’affirmer que c’est par cette antériorité (fût-elle logique) que l’action de l’être reçoit son sens d’action : les choses n’agissent pas, elles produisent de l’énergie et du mouvement, et non pas des actes.
La vérité est que la conscience est simultanément source d’une action et source de son sens. Celui-ci peut bien être imaginaire, erroné, inadéquat ou contre-productif, il n’en reste pas moins un sens, une signification, et seule la conscience antérieure peut donner un sens à un mouvement. Cette antériorité est le pouvoir constituant de la conscience, ce pouvoir constituant étant, comme antériorité, à la fois premisses, énergie, invention et instauration.
Il n’y a là aucun sophisme. Est simplement devenu clair le fait que, dans un apparent paradoxe, la conscience se précède elle-même. Ou plutôt elle paraît se précéder elle-même. En fait, elle surgit d’un seul mouvement qui est simultanément source de sa propre existence et source de son propre sens. Lorsque, dans un stade, un but est marqué au cours d’un match (de tennis ou de football), c’est dans une fraction de seconde que, brusquement, la moitié du stade crie sa joie, tandis que l’autre moitié crie sa déception. Et c’est dans la seconde même où est marqué le but que le spectateur affirme brusquement dans un acte (le cri) une signification (un but a été marqué) et un jugement existentiel (joie ou déception).
Et c’est cette triple signification qui est impliquée dans le geste du spectateur, c’est-à-dire son acte. Et c’est ce spectateur qui a décidé cet acte. Il en est la source et matérielle (il crie) et intellectuelle (il exprime un sens et une prise de position affective et valorisante). Pour le dire d’une manière synthétique, le spectateur de notre exemple est décideur et constituant. Sa conscience, son « émotion» est, d’un seul mouvement, créatrice et constituante. Elle fait surgir un geste, un sens et un affect qui n’existaient pas avant qu’elle n’en pose l’initiative et la réalisation.
C’est cette initiative, créatrice de sens et d’existence, qui caractérise la conscience et qui la pose paradoxalement comme si elle était antérieure à elle-même : elle sait ce qu’elle veut poser, et elle le sait une fraction de seconde avant même qu’elle ne le pose.
Parce que la conscience est constituante (et du fait et du sens), elle est autocréatrice. Auto-affirmative. Son antériorité à elle-même est son autonomie.
Certes, cette antériorité qui est l’autonomie existentielle et logique d’un acte peut être erronée ou inadéquate : le but n’était pas réellement marqué, il fut contesté parce qu’un joueur avait touché le ballon. Il n’en reste pas moins que la conscience du spectateur (fût-ce dans sa propre illusion) fut créatrice, constituante et antérieure. Cette analyse a une valeur universelle : elle peut être appliquée à tout acte humain.
La première conséquence de cette analyse est l’indispensable affirmation de la liberté. Il y a certes lieu de distinguer deux niveaux ou deux formes de cette liberté : un niveau spontané et un niveau réfléchi. De ces deux libertés nous avons longuement traité ailleurs.
Ici, nous voudrions souligner une autre caractéristique, un autre contenu de sens de cette antériorité créatrice de la conscience constituante.
Ce qui est remarquable, en effet, c’est que la conscience spontanée ne sait pas qu’elle est constituante. Le spectateur sportif ne sait pas, ne croit pas qu’il soit créateur du sens de ses actes. Il ne sait pas que c’est son regard, sa culture, ses choix qui posent et constituent l’événement auquel il croit simplement réagir. Il pense « naïvement» (comme disent certains philosophes) que la compétition à laquelle il assiste a réellement un sens objectif, et que, réellement, il y a eu un but marqué ou contesté. Même sans nous référer à l’acte de constitution du sens par la conscience, et en ne retenant que l’idée plus simple de convention, le spectateur ne songe à aucun moment ni à la convention qui définit (et… constitue) les règles du jeu, ni au pouvoir constituant des consciences qui reconnaissent ces règles et en tirent des conséquences affectives et pratiques.
Je ne dis pas le moins du monde que le spectateur est inconscient de son autonomie : celle-ci est implicite. Il ressent implicitement un sentiment de liberté dans le mouvement de sa joie ou de sa déception : il bondit, il crie, il se replie, avec la conscience pour ainsi dire marginale de bondir ou de crier librement. Ce sentiment de liberté, cette conscience d’un libre comportement ne sont pas des illusions – mais ce ne sont que des consciences partielles.
Le spectateur empirique a le sentiment de la liberté de ses actes (il peut décider de descendre sur le terrain ou de sortir, ou bien de crier), mais il ne songe pas au fait qu’il est intellectuellement créateur. Il ne pense ni au caractère conventionnel du rapport aux équipes, ni à sa propre activité intellectuelle et affective au cours du match. Il croit recevoir des informations objectives et réagir simplement (passivement) au cours des choses, alors que, en fait, il est actif, libre et créateur de significations et d’émotions. Il y a là comme un non-savoir. On ne doit pas appauvrir ou caricaturer ce non-savoir en le nommant « inconscient », c’est-à-dire en faisant découler les gestes visibles du spectateur d’un inconscient invisible qui agirait en lui sans lui.
Mais la situation est complexe.
La phénoménologie de Husserl peut certes nous aider à comprendre ce phénomène quotidien qu’est un acte ayant du sens. On parlera alors d’intentionnalité. La conscience est par elle-même un mouvement intentionnel créateur du sens de son objet et du sens même de l’idée d’objet. Elle est cette énergie créatrice dirigée intentionnellement vers un but : poser un sens et y réagir.
Et, souligne constamment Husserl, cette intentionnalité est implicite ; il faut que nous, observateurs, nous l’affirmions pour que la conscience d’objet ait en effet un sens.
Nous avons toujours souscrit (et souscrivons encore) à ces analyses husserliennes. Mais nous restons attentif à une difficulté : que signifie le fait de n’être pas conscient de la création d’un sens? Que signifie le fait que l’ego constituant ne soit pas l’objet spontané d’une conscience active dans le monde ?
Faut-il parler avec Kant d’un ego transcendantal qui serait par définition hors d’atteinte et échapperait à toute prise de conscience? Kant a posé un réel problème. Mais son hypothèse reste soustraite à toute vérification. Et elle laisse dans l’ombre la question du rapport effectif entre un ego inconscient et la pensée claire des catégories logiques ou des formes a priori de l’intuition. D’ailleurs, la science contemporaine met en question aussi bien la catégorie de la causalité (l’idée de loi et de relation remplaçant l’idée de cause productrice) que la forme sensible du temps (avec l’invention mathématique de l’espace-temps).
Husserl comprend bien que la transcendance réelle de l’ego n’est pas recevable. Il pense que l’idée d’une implication logique de l’intentionnalité dans les jugements explicites permet à la fois de renoncer à une transcendance réaliste mais fictive de l’ego, tout en conservant le caractère rationnellement créateur de la conscience pensante. Il en est bien partiellement ainsi : un je, un sujet, est bien présent, fût-ce implicitement, dans tous les actes de la conscience.
La difficulté reste entière: que signifie le fait de la non-conscience ordinaire du pouvoir constituant et créateur de la conscience ?
Parce que ce pouvoir est, comme dit Husserl, implicite, il peut toujours être explicité. On peut toujours passer de l’implicite à l’explicite, et de la conscience immédiate à la conscience réfléchie et créatrice. « La conscience s’apprend », dit Husserl.
Et nous l’avons vu plus haut: ce qui est refusé dans le déni du sujet constituant c’est la responsabilité de l’homme lui-même dans les malheurs qui le frappent.
Mais pourquoi le non-savoir de la conscience ordinaire quant à son action constituante ?
On pourrait, semble-t-il, invoquer des raisons psychologiques, des motivations qui seraient de l’ordre du refus, de la « résistance» comme disent les psychanalystes, ou de la « mauvaise foi » comme disait Sartre.
Pour que cette explication soit valable, il faudrait au moins que le sujet éprouve un affect qu’il refuserait cependant en tant qu’il serait à ses yeux illusoire. C’est ce qui se produit à propos de la liberté : tous les sujets éprouvent le sentiment de la contingence de leurs actes, mais un grand nombre d’entre eux tiennent ce sentiment pour illusoire, et affirment avec Spinoza (répétons-le) que la liberté n’est que l’ignorance des causes qui nous font agir ; à quoi je réponds que le déterminisme des motifs n’est que l’ignorance des initiatives qui nous font agir. Et, à partir de là, on peut distinguer deux niveaux de la liberté.
Mais qu’en est-il du pouvoir constituant lui-même ? Aucune conscience n’a, directement, la conscience de son pouvoir constituant ; il n’est donc même pas question de le contester, de le refuser et de le tenir pour une illusion : il est, simplement et radicalement, ignoré. Il n’y a pas d’expérience du pouvoir constituant de la conscience. Et pourtant il existe. Savoir lire les idéogrammes chinois c’est constituer (comprendre et affirmer) que des signes peuvent être revêtus d’un sens ; et c’est le lecteur qui constitue ce sens, et non pas les signes par eux-mêmes.
C’est ici, on l’a vu, qu’intervient, dans l’histoire de la pensée, l’hypothèse trop commode d’un agent non conscient et transcendantal, immanent pourtant à la conscience, dénommé l’« âme » ou l’« ego ». Qu’on se souvienne de la « réminiscence » chez Platon, des « idées innées » chez Descartes, des « catégories » et des « formes a priori » chez Kant, du « devenir du concept » chez Hegel. On peut même, dans cette ligne, évoquer l’affirmation de Lacan : « Ça pense en moi»; c’est alors l’inconscient qui joue le rôle de l’ego transcendantal.
Toutes ces hypothèses sont à la fois arbitraires (puisqu’elles s’inscrivent dans des systèmes et des vocabulaires particuliers, « poétiques », dirons-nous) et significatives. Elles ne sont pas absurdes ; elles répondent à des expériences réelles qu’on interprète et surtout elles expriment toutes un problème réel et des faits réels : il n’est pas immédiatement intelligible qu’on fasse une expérience de fausse reconnaissance, ou que l’on admette le principe de non-contradiction, ou que l’on comprenne la symétrie inverse de deux images non directement superposables, ou bien encore qu’on se présente à un concours en traînant les pieds. Mais, si toutes ces hypothèses philosophiques ont le mérite de cerner peu à peu un même problème, elles ont l’inconvénient d’être dogmatiques: un dogme est une affirmation ne pouvant jamais faire l’objet d’une vérification logique, existentielle et expérimentale.
Nous sommes donc renvoyés à ce fait primitif et universel : comme le dit Husserl (avec sa description de l’intentionnalité implicite et donatrice de sens) et aussi le linguiste Benveniste (avec sa référence à l’indispensable et implicite affirmation du pronom personnel « je » pour qu’une phrase écrite ou prononcée ait un sens), la conscience doit être affirmée comme constituante si l’on veut rendre compte de l’émergence de l’idée de sens et de ses significations régionales et singulières.
Je ne crains pas de me répéter : c’est souligner, pour moi-même et pour mon lecteur, l’importance décisive d’une idée.)
Nous comprenons maintenant la place centrale de l’acte de constitution (d’un sens, d’un objet, d’un monde) : cet acte est lui-même la conscience, il est constitutif de la conscience.
Nous comprenons donc mieux la portée de la question qui nous occupe depuis le début : pourquoi l’activité de constitution fait l’objet d’une telle ignorance de la part de la culture contemporaine. Cette question est, plus profondément, la question de savoir quelle est la véritable nature de la conscience et quel est donc, par conséquent, son véritable pouvoir : c’est cette conscience et ce pouvoir qui sont refusés par l’opinion dominante.
Or nous avons rejeté l’idée d’une transcendance de l’ego, c’est-à-dire l’affirmation sans preuve de l’existence d’un autre sujet derrière le sujet lui-même. Nous avons refusé l’existence d’une réalité substantielle psychique et inconsciente, réalité distincte du sujet et qui l’animerait.
La seule affirmation qui reste vraisemblable est que c’est en effet le sujet lui-même qui est cet être non su qui crée et pose les significations. Cela implique immédiatement qu’il peut toujours s’aviser lui-même de son propre pouvoir, mais qu’il n’en a pas ordinairement le désir.
Tout se passe donc comme si le sujet était à la fois le sujet concret de la réflexivité quotidienne et l’aspect hors champ de ce même sujet. C’est l’aspect hors champ qui est l’activité constituante du sujet concret lui-même. Cet aspect hors champ nous l’appellerons le hors-monde.
Tout se passe donc comme si l’individu concret (qui est réflexivité et désir, et qui peut toujours redoubler sa conscience de soi et devenir réflexion), cet individu qui déploie un monde significatif, était porté ou inspiré par une puissance en lui qui est hors monde. Il faudrait alors reconnaître que la véritable source du monde est, dans le sujet lui-même, ce qui est antérieur au monde et donc hors monde.
Une expérience quotidienne, dans la perception, peut éclairer cette réalité paradoxale. Quand nous percevons un objet matériel dans l’espace, nous affirmons à la fois un sens (c’est une table de cuisine ou une table d’opération) et un aspect invisible : l’objet est certes tout entier une table, mais il comporte à l’évidence une face cachée. Je ne perçois pas en même temps tous les aspects, tous les côtés, toutes les perspectives de la table, mais je sais que les aspects non vus font cependant parties intégrantes de l’objet.
Il en va de même pour le sujet : on peut à la fois saisir son activité consciente et reconnaître en lui un aspect non directement saisi mais toujours nécessairement impliqué. C’est cet aspect implicite du sujet, cette dimension non perçue du sujet perçu que j’appelle le hors-monde.
C’est (en chaque être humain) le hors-monde qui constitue le monde : il le pose simultanément comme unité organique, comme unité toujours et seulement perçue en perspective, et toujours porteuse des significations qu’il lui confère par son action. Les « opportunités » qu’offre le monde viennent en fait de mon désir et de mon regard. Ce désir créateur de désirabilité, ce regard « révélateur » de significations sont eux-mêmes constitués de l’intérieur par cela qui, dans le sujet, est hors monde.
Hors monde : c’est-à-dire rarement et difficilement perçu mais toujours et nécessairement impliqué. Et toujours « explicitable». Et donc toujours actuel.
Mais pourquoi cette difficulté à en reconnaître l’existence ?
Il me semble que ce refus provient d’abord d’une sorte de modestie existentielle. Le sujet, conscient de lui-même comme d’un corps-sujet ayant à agir dans un monde difficile, se saisit comme fragilité. Le sentiment de la finitude de l’homme est bien connu des écrivains et des philosophes, il n’est pas nécessaire d’être un penseur tragique pour s’interroger sur la précarité de l’existence, sur la maladie et sur la mort. À partir de là, toute affirmation de puissance spirituelle paraîtra présomptueuse. Comment un être aussi fragile que l’être humain pourrait-il être « constituant » de son univers ou de certains de ses éléments ? Mais cette réticence s’aveugle sur la nature de son attachement à la vie. C’est l’attachement à la vie qui donne envie de vivre, c’est-à-dire d’agir dans un monde significatif et d’y atteindre des buts; cet attachement, cette envie sont le désir même, et c’est lui qui donne sens aux valeurs et aux buts, c’est-à-dire au monde concret.
Le désir est donc un engagement dans la chair du temps et, à ce titre, il est créateur. Même s’il n’était créateur que des significations élémentaires du monde (la désirabilité des biens), le sujet du désir aurait tort d’être aveuglé par sa modestie et sa précarité, c’est-à-dire sa finitude.
C’est dans le cadre de cette finitude que le sujet est créateur d’un monde, avec ses difficultés et ses perspectives.
Une fois écartée la modestie existentielle (parfois appelée « humilité»), l’individu devrait pouvoir saisir en lui cette part qui est créatrice. Et c’est en effet ce qui se produit parfois : on reconnaît parfois l’œuvre créatrice de l’esprit humain dans les domaines de l’art et de la « morale », c’est-à-dire dans le domaine des valeurs; on reconnaît même parfois que la « politique» est créatrice et que l’histoire n’est pas un développement nécessaire et préétabli, une « fatalité ».
Mais notre question concerne, dans le sujet, un domaine antérieur à toute création empirique de valeur : il s’agit du hors-monde, ou du sujet hors monde. Il fonde toutes les significations, et c’est cette toute-puissance spirituelle que l’opinion dominante répugne à reconnaître.
C’est que, au-delà de la modestie existentielle, se profile le souci d’une sorte de sécurité métaphysique. Le sujet spontané, assuré de sa finitude, anticipe obscurément les dangers qui le menaceraient s’il se reconnaissait une puissance spirituelle constituante. Ces dangers ne seraient pas d’origine extérieure, ils proviendraient du sujet lui-même : le voici qui deviendrait « capable de tout ». Il serait la source de tout sens et serait donc en mesure de déployer une générosité absolue ou une cruauté absolue. Il risquerait d’être « possédé » par un démon ou « inspiré » par un ange. Il y aurait alors un champ laissé libre pour l’angoisse.
On peut faire l’hypothèse que Sartre fut lucide : on sait qu’il relie la conscience de la liberté à la conscience de l’angoisse, celle-ci provenant du fait que toutes les valeurs et tous les choix seraient équivalents. Mais Sartre reste sur le plan des actions dans le monde, il rappelle souvent que l’homme est « chose parmi les choses », et, s’il refuse un ego transcendantal, c’est pour le remplacer par des « qualités » et des « états » qui réduisent la conscience à ce qu’elle éprouve directement dans le présent de l’action en cours. S’il dépasse ce stade (comme dans L’Être et le Néant), il se borne à définir le pour-soi par la négation et la néantisation. Phénoménologue, il n’a pourtant pas retenu ni aperçu le pouvoir constituant du sujet : en réalité il nie jusqu’à l’existence d’un sujet.
Revenons à notre analyse : l’opinion récuse tout pouvoir réellement constituant non pas seulement par modestie, mais aussi par prudence existentielle. Elle craint les conséquences dévastatrices d’une telle position. Le sujet, à la fois dans le monde et hors monde, deviendrait source de toute action et critère de tout jugement; il deviendrait pratiquement l’origine du monde, à la fois fons et origo, dieu caché et deus ex machina.
Le recul devant un tel risque éthique et existentiel n’est pas seulement une précaution morale devant les dangers de la toute-puissance, il est aussi le refus de tout mysticisme. C’est la crainte de tomber dans le mysticisme en passant par l’idéalisme qui motive l’opinion dominante dans son refus d’un pouvoir totalement constituant de la conscience humaine. Après Kant, Fichte n’a pas su convaincre et sa doctrine du moi créateur a toujours semblé une rêverie métaphysique.
Mais l’histoire politique, depuis le régime nazi et ses camps d’extermination jusqu’à l’islam fondamentaliste et ses massacres, n’a-t-elle pas prouvé que, en effet, la conscience humaine est « capable de tout » ? À côté de ce plan pratique, la conscience scientifique et la conscience esthétique n’ont-elles pas amplement prouvé que l’homme peut inventer n’importe quoi, depuis la matière invisible et les corpuscules ondulatoires jusqu’à l’œuvre de Bacon ou d’Alban Berg?
Mais la résistance au hors-monde est forte. Un ego constituant, même s’il n’est ni démoniaque ni divin, paraîtra encore revêtu d’une « inquiétante étrangeté ». L’opinion dominante se refuse à reconnaître l’existence et l’activité d’une puissance intérieure qui pourrait maîtriser le domaine dont se sont déjà emparées la psychanalyse ou la littérature fantastique. Un pouvoir constituant, aux yeux de l’opinion philosophique dominante, ne laisserait pas se développer dans le moi les délires de la psychose ou les fascinations de la magie, délires et fascinations qui, eux, « existent ».
Par la crainte de justifier les débordements de la passion ou les fantaisies de la magie, l’opinion dominante refusera longtemps l’idée d’un sujet hors monde. Non seulement cette instance lui paraît inquiétante ou fantasmatique, mais encore elle lui semble parfaitement abstraite.
Que peut en effet représenter, pour une pensée quotidienne et commune, cette affirmation selon laquelle c’est la conscience humaine individuelle qui constitue, fonde, rend possible et donc crée toute signification ? Au regard de cette pensée, l’affirmation du hors-monde ne saurait être qu’abstraite : soit qu’elle ne désigne en effet rien de visible ou de perceptible dans le sujet, soit que l’étendue de son pouvoir et de son action la vide en réalité de tout contenu.
Le hors-monde ne semblera à l’opinion ni clair (puisqu’il n’a pas de contenu, étant la condition de tout contenu) ni distinct (puisqu’on ne peut distinguer le pouvoir constituant du hors-monde et les autres pouvoirs de création comme l’activité politique, artistique ou scientifique).
Pour l’opinion dominante, il n’existe dans le sujet individuel ni deus ex machina, ni fons et origo, ni transcendance, ni puissance « spirituelle » : il n’existe que des situations, des forces, des données, des pulsions, c’est-à-dire des choses et leurs forces, des états et leurs relations.
Il me semble que l’on peut maintenant réfléchir aux conséquences qui découlent ou du refus ou de la reconnaissance de cette réalité hors monde qu’est, dans le sujet et dans lui seul, sans référence à aucun dieu ou extérieur ou intérieur, son pouvoir constituant universel. Que découle-t-il de la négation ou de l’affirmation du sujet hors monde?
Le premier résultat d’un tel refus est l’impossibilité de la liberté elle-même. Si le sujet n’a aucun pouvoir constituant, il est réduit à l’état passif de récepteur. Il ne saurait prendre aucune initiative puisque toutes les motivations lui viendraient de l’extérieur (le mystère restant entier de comprendre comment des motifs d’action peuvent être objectivement inscrits dans les choses).
Certes, c’est le désir qui, en première analyse, crée la désirabilité de l’objet et donc les motivations de l’action. Mais on doit précisément ajouter ici que le sujet hors monde est également impliqué par le désir, et que celui-ci est consti-tuant. C’est en cela que consiste le paradoxe : le désir est un dynamisme qualitatif, un manque sensible, et en même temps il crée du sens et des motivations, il est un sujet en première personne qui ne songe pas à son pouvoir constituant, mais se préoccupe seulement de son rapport à un objet apparemment « donné ». C’est cette vue du désir, créatrice et inventrice, qui est rendue impossible et incompréhensible, si l’on refuse le pouvoir hors monde du sujet, c’est-à-dire son pouvoir constituant.
Et ce sujet hors monde, qui est forcément immanent à tout désir, est le fondement de toutes les formes de la liberté. C’est lui en effet qui décide, au cœur de la réflexivité quotidienne, de passer à la réflexion et à la forme réfléchie de la liberté. Ce ne sont ni une raison ni une âme qui gouverneraient de l’extérieur les désirs et les passions, c’est le sujet lui-même (en tant qu’il est le hors-monde du désir) qui pose et crée les significations et les motivations, les attitudes et les choix.
Le second résultat du refus de ce sujet hors monde est la méconnaissance stupéfiante de la responsabilité humaine dans les malheurs de l’humanité. Pour la conscience quotidienne (que certains philosophes nomment « conscience naive »), toutes les souffrances et les difficultés de l’existence proviennent des conditions et des causes extérieures, qu’elles soient sociologiques, psychologiques ou politiques. Un déterminisme global est affirmé.
Certes, il s’agit là du débat sur la liberté, puisqu’elle seule confère la responsabilité. Mais le refus de la responsabilité est pourtant spécifique. Il va plus loin que le simple refus de la liberté puisqu’il refuse aussi d’être reconnu coupable en tant que source des souffrances produites. Et ce refus en profondeur de l’efficacité nocive d’une attitude ou d’une action provient du refus d’un quelconque pouvoir constituant des protagonistes d’un drame, qu’il soit social ou personnel.
Prenons un exemple concret, le chômage. Je ne dis pas que le chômeur est responsable parce qu’il refuserait tout travail. Je dis que les syndicats (qui défendent en effet et à bon droit les intérêts des travailleurs) ne savent pas inventer, ou ne souhaitent pas inventer et soutenir une politique efficace dans les affaires sociales. Une autre attitude, une autre politique, un autre combat sont toujours possibles, et cela indépendamment de tous les procès d’intention qu’on pourrait faire aux initiateurs de tels « changements ».
Jusqu’ici, dans notre exemple, ne sont concernés, semble-t-il, que les faits de la liberté politique et de la contingence de l’histoire et de l’économie. Mais on peut poursuivre l’analyse et tenter de mieux creuser les phénomènes qui se produisent en tant qu’événements. On peut voir en effet que, au cœur même de la revendi-cation, se trouvent deux activités : le choix et la définition des revendications (salaires, primes, conditions de travail par exemple), ainsi que le choix des formes du combat. Ici se placent le libre choix d’une politique et la question traditionnelle de la liberté dans l’histoire. Ensuite, dans ce combat, se trouve engagée une seconde activité : la donation de sens.
Il est clair que cette question n’intéressera pas le syndicaliste ni le chômeur. Elle est pourtant essentielle. On ne peut comprendre le questionnement politique concret que si l’on connaît non seulement la nature des enjeux (existence des individus, état d’une économie), mais encore la source de la signification même des enjeux et des revendications. Or, à propos des enjeux, on doit reconnaître que ce sont les chômeurs eux-mêmes qui les définissent et les constituent, et cela d’une manière immédiate, profonde et non sue : c’est le chômeur lui-même qui considérera (et nous avec lui) qu’il y a une souffrance inacceptable dans sa situation ; c’est lui qui considérera que ses anciens employeurs sont responsables de son malheur, ou bien que ce sont les dirigeants politiques; c’est lui encore qui « imposera » ou « refusera » telle ou telle négociation salariale.
Mieux (et plus paradoxal ou scandaleux) : c’est le chômeur qui définit le chômage, c’est-à-dire la signification complète de cet état. Sont en effet impliquées, dans la définition du chômage, une conception du travail salarié, une conception de l’économie globale du pays, une conception de l’existence humaine (laborieuse, oisive, studieuse, artiste, etc.) et de sa « valeur » (dignité, indignité, humanité, solidarité, solitude, etc.). Bref, l’état de « chômeur » est une situation surdéterminée du point de vue du sens et du statut; et ce statut, apparemment objectif, suppose en réalité de nombreuses affirmations de sens et de nombreuses perspectives pratiques. Le champ de ces affirmations est fort vaste : existentiel, social, politique, éthique. Et ce vaste champ significatif qui définit le chômage est simultanément affirmé et constitué par la plupart des protagonistes : les chômeurs, les employeurs, les dirigeants, la population. Ce champ significatif devient ainsi un « fait de société », un fait social, mais il ne cesse pas pour autant d’être le fruit des multiples affirmations individuelles qui, ensemble, constituent et l’idée et la réalité du chômage. Celles-ci sont le fruit du même acte constituant que celui qui « fonde » la société capitaliste, avec toutes ses « définitions» de l’économie (propriété, salaire, code du travail, etc.).
Pourquoi tant insister sur le sens? C’est que lui seul, comme affirmation créatrice, rend possible non seulement la liberté des protagonistes, mais encore la prise de conscience de cette liberté, la prise de conscience de cette inéluctable liberté, l’accès à l’évidence jusqu’ici voilée de la liberté créatrice du sujet.
Et c’est ici qu’est également rendue possible la reconnaissance, par les protagonistes, de leur totale responsabilité dans le cours de l’histoire. La comparaison de l’économie de plusieurs pays montre bien que le chômage de masse n’est pas inéluctable, même en régime capitaliste, mais seule la référence à un sujet fondateur, plus profond et intérieur que le sujet quotidien des revendications, seule cette référence est en mesure de nous convaincre de la liberté et capable de justifier un combat pour cette liberté, c’est-à-dire pour le libre épanouissement du désir.
J’appellerai « irresponsabilité » l’attitude d’ignorance ou de dénégation face à l’efficacité et à la causalité de fait des sujets individuels (rassemblés ou non) dans l’émergence des malheurs ou des difficultés dans l’existence individuelle et collective.
Il n’y a là aucun procès d’intention. L’irresponsabilité exprime le plus souvent une position sincère de réserve quant aux pouvoirs constituants des individus. C’est dire que, le plus souvent, elle est de bonne foi. Elle peut à la fois affirmer l’existence d’une liberté et d’une contingence pratiques dans la conduite d’un combat, et nier l’existence d’un « je » fondamental et fondateur qui serait la source de toutes les valeurs et significations tenues pour objectives. C’est, par exemple, le cas de la philosophie de Sartre : il défend une liberté absolue (et combat effectivement le colonialisme ou le capitalisme) mais, comme on l’a déjà remarqué, il nie l’existence d’un ego transcendantal qui serait au-dessus du sujet comme un surmoi.
Mais les effets de l’irresponsabilité — cette méconnaissance du sujet hors monde — sont catastrophiques : elle est un laisser-faire et, puisque l’acte de constitution et la liberté sont effectivement présents, elle est aussi une complicité. La lucidité oblige à attribuer à cette complicité involontaire l’origine de la violence sociale : racisme, fanatisme religieux, exploitation des travailleurs adultes ou mineurs, guerres de conquête, domination politique, spéculations et manœuvres sur les biens de consommation, destruction des richesses naturelles et des sources d’énergie, rapport financier à l’art et à la création (qui, du coup, est reconnue comme telle), mépris des immigrés, mépris des pays d’accueil, mépris dominant de la culture, présomption et ignorance dans les politiques de la culture et de l’éducation, frénésie de consommation, indifférence à l’égard des personnes sans logement, usage de la torture ici ou là, mépris de la femme et de la sexualité féminine dans de nombreux peuples, mépris de la vie, diffusion de la superstition sous couvert de religion, éloge de la violence, politique et développement de l’usage des drogues et de la violence criminelle.
Les maux sont innombrables. C’est s’en rendre complice que de les attribuer mécaniquement à l’action d’un système politique et économique, alors que tous les systèmes sont le fruit de choix parfois explicites et toujours irresponsables. Il faut le redire : si, en tous ces maux « il n’y a pas de fatalité» (comme on le dit partout), alors c’est que leur origine est la liberté et, dans cette liberté dynamique, le pouvoir constituant de la conscience. Il constitue tout : toutes les valeurs, tous les contenus, tous les choix, fût-ce celui de l’ignorance et de la complicité, fût-ce la dénégation du sujet hors monde, ce sujet source présent en toute conscience.
Il ne suffit pas (il ne me suffit pas) de protester contre les injustices et les intolérances, contre l’ignorance et l’arbitraire. Il ne suffit pas de se révolter ou de s’indigner. Il faut comprendre que s’il y a en tout cela un mal, c’est qu’il y a des consciences qui le créent et des consciences qui le jugent. C’est la reconnaissance de cette efficacité des consciences, aussi bien dans la définition du mal que dans les choix qui l’engendrent ou qui le combattent, c’est cette reconnaissance d’un pouvoir efficace et constituant de la conscience qui seule serait en mesure d’organiser un combat sérieux contre le désastre généralisé.
Mais la situation du hors-monde lui-même peut être difficile. Pour que les étapes ou les modalités d’un combat puissent être envisagées, il faut auparavant être au clair sur la situation effective du hors-monde. Sur ce qu’elle est parfois, en tout cas.
Le hors-monde, ce sujet constructeur immanent au sujet lui-même, qu’il soit spontané ou réfléchi, ne peut évidemment être directement perçu que par lui-même. C’est moi seul (chacun des êtres humains) qui peux prendre conscience et de mon pouvoir constituant et de mon isolement hors de ce monde qui n’existe que par moi. Source de tout sens, le hors-monde risque, en se percevant, de se situer en effet hors du réel. Existe-t-il vraiment ? S’il existe, quelle existence, quel sens peut-il avoir lui-même puisque, hors de son action, il n’y a pas de sens et qu’il s’interroge sur la source de toute action ?
Soucieux de rigueur, il ne saurait être question que je me satisfasse d’une solution théologique à la façon d’un Georges Bataille ou d’un mystique médiéval. Ce dieu caché qui serait hors de toute qualification et donc purement négatif, ce dieu caché qui serait également présent au fond de moi-même (comme le pense Angelus Silesius) n’est qu’une pure fiction. Ils ont raison de se méfier du mysticisme ceux qui rejettent l’idée d’un sujet constituant, d’un ego transcendantal qui existerait substantiellement au cœur du sujet sans pouvoir être perçu. Ma situation est donc compliquée puisque, tout en rejetant le mysticisme et le substantialisme, je persévère dans mon affirmation : au cœur même de toute conscience concrète, au cœur de tout existant, réside un sujet constituant difficilement perceptible. Cette situation compliquée du sujet qui s’interroge inlassablement sur la nature de ses désirs, puis de son désir, puis de sa puissance créatrice de valeurs, puis de son ultime pouvoir constituant, un tel sujet ne risque-t-il pas de connaître une scission interne si profonde qu’il se trouverait finalement rejeté lui-même hors du monde réel ? L’idée d’un sujet hors monde n’est-elle pas la source d’un exil hors du monde ?
Non seulement c’est le sujet lui-même qui, creusant sans cesse l’emboîtement de ses pouvoirs, s’éloigne du monde réel, mais c’est aussi la majorité des autres existants qui rejette ce sujet hors du monde commun, ce sujet coupable qui prétend dévoiler l’origine du monde. Ne mérite-t-il pas l’ostracisme ou l’exil, la mort même s’il parle trop sur l’agora? Qu’il soit grec, comme Socrate, juif hérétique, comme Spinoza, ou juif converti, comme Husserl, ne mérite-t-il pas une condamnation majeure ? Et, puisqu’il en appelle au hors-monde, pourquoi le laisserait-on exister encore dans le monde central de la réalité ? Excommunication ou révocation, voilà ce que méritent ces philosophes.
Certes, les philosophes ne sont pas les seuls qui subissent ou l’exil ou la mort pour raisons politiques ou idéologiques. On songera aux procès en sorcellerie, ou à Galilée, ou aux victimes de la Terreur en 1793 ou des procès de Moscou dans les années 1950.
Mais la situation est pourtant préoccupante si elle n’est pas aujourd’hui tragique.
Car, enfin, ce qui est en cause est finalement la nature et le sort de la liberté. La possibilité de choisir librement ses actions et leurs motivations (possibilité qui est la condition de la démocratie, presqu’universellement revendiquée), cette possibilité pratique repose finalement sur le pouvoir effectif de créer de toutes pièces du sens, de la valeur et de la vérité.
Et nous l’avons vu plus haut: ce qui est refusé dans le déni du sujet constituant c’est la responsabilité de l’homme lui-même dans les malheurs qui le frappent.
Qu’il faille une sorte de courage existentiel pour admettre ces vérités, c’est l’évidence. Mais il y faut aussi des motivations.
La situation semble devenir alors particulièrement délicate. Car si tout sens et donc toute motivation proviennent du hors-monde, tout désirable provient du désir.
Si l’on veut éviter la multiplication arbitraire des instances ou des facultés (comme chez Aristote, chez Kant ou chez Freud), il faut bien se résoudre à admettre que le hors-monde se trouve non seulement au cœur du sujet mais aussi (et par là même) au cœur du désir. C’est donc le désir-sujet lui-même qui est aussi en même temps sujet hors monde.
Son pouvoir constituant est celui-là même du sujet hors monde : la désirabilité d’une fin est totalement constituée par le désir, puisque le désir est sujet et que le sujet est désir.
C’est donc à partir de lui-même (qu’on le voie comme désir ou qu’on le voie comme sujet) que le hors-monde a à constituer et affirmer des motivations pour combattre l’irresponsabilité dans le monde et la complicité avec le malheur.
Le hors-monde part de lui-même et de lui seul. Il est causa sui, il est sa propre cause. Il est la source de ses pensées, c’est-à-dire aussi la source de ses désirs. Il est livré à lui-même.
Il peut dès lors choisir la gratuité absolue de l’existence et de toutes ses formes, ou la passivité et la complicité avec l’aliénation générale dont il souffrira lui-même. Il peut au contraire choisir l’activité créatrice qui s’attachera à l’épanouissement réfléchi du désir.
Ici se profile une voie que nous avons longuement explorée ailleurs : en passant de la souffrance de la crise au choix drastique de la conversion et du recommencement, le sujet réfléchi, c’est-à-dire le désir-sujet réfléchi, se rend lui-même capable de construire une éthique neuve. Elle est une éthique de la joie et du bonheur, c’est-à-dire un itinéraire existentiel qui conduira au préférable et au substantiel, c’est-à-dire à la jouissance d’être.
On sait que cette philosophie n’a pas eu d’action visible dans les affaires de notre temps. Ce livre part de ce constat : l’opinion ne souhaite guère se familiariser avec une telle doctrine dans la mesure même où, en fin de compte, elle comprend qu’elle aurait alors à admettre l’idée d’un sujet totalement constituant et responsable. Ce sujet hors monde, antérieur à tout acte et à tout sens, source implicite de toute activité et de toute signification, et finalement véritable cause de lui-même et du monde, ce sujet paraît à la fois trop idéaliste, trop lointain et trop compromettant pour être utile. Il ne saurait, croit-on, résoudre les problèmes de la vie concrète.
Hors monde en effet, il est disqualifié non seulement par l’opinion, mais aussi par la philosophie dominante. Ce faisant, la violence et l’aliénation vont crois-sant.
On le voit, chacun est finalement placé devant le vide, mais aussi devant sa propre responsabilité. Ce qui reste stupéfiant c’est que l’on continue imperturbablement à revendiquer confort, justice et libertés, tout en s’inclinant devant des lois de toutes sortes supposées toutes-puissantes (le « réel », le « raisonnable », le « sérieux»). Le libre sujet créateur est, aux yeux de l’opinion, le mal incarné ou l’illusion par excellence.
C’est que, en fait et en fin de compte, l’opinion et les médias refusent majoritairement la validité de la philosophie. Tout juste consentent-elles à la populariser, la réduisant ainsi à un objet de consommation culturelle sans conséquence.
On pourrait croire que cette position est « pessimiste ». L’humanité serait en fait condamnée à souffrir toujours dans la mesure où, décidément, elle refuse constamment de reconnaître le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la liberté.
Cette position pessimiste ne saurait valoir comme doctrine. Elle serait contradictoire dans la mesure où, tout en déplorant qu’on ne reconnaisse pas la liberté véritable, elle ne reconnaîtrait pas le pouvoir de cette liberté, c’est-à-dire aussi son propre pouvoir régénérateur.
En fait, et par l’action même du sujet hors monde, chacun est placé devant sa propre souffrance, devant sa propre force, devant sa propre joie.
Si le hors-monde crée lui-même le monde, il peut le remodeler. Il n’a justement pas d’autre fonction que de créer un monde. C’est le hors-monde lui-même qui peut décider l’accès à la jouissance du monde. C’est une création. Et la joie de la création (celle des œuvres et, d’abord, celle du monde) est l’expression la plus joyeuse de cette vérité logique et existentielle qu’est, en tout un chacun, la création par soi, la causalité par soi. Ce pouvoir constituant, qui est aussi la création simultanée de soi-même et du monde, est également la jouissance simultanée de soi-même et du monde.
En fait, le hors-monde se propose d’instaurer les conditions de la jouissance d’être. C’est donc par le monde qu’il crée lui-même que le hors-monde s’accomplit lui-même comme jouissance et comme monde. Étant hors monde, il peut créer un monde pour s’en réjouir. Et c’est pour se réjouir et du monde et de soi-même que le hors-monde se crée lui-même, découvrant alors ainsi l’universelle possibilité de la libre joie.