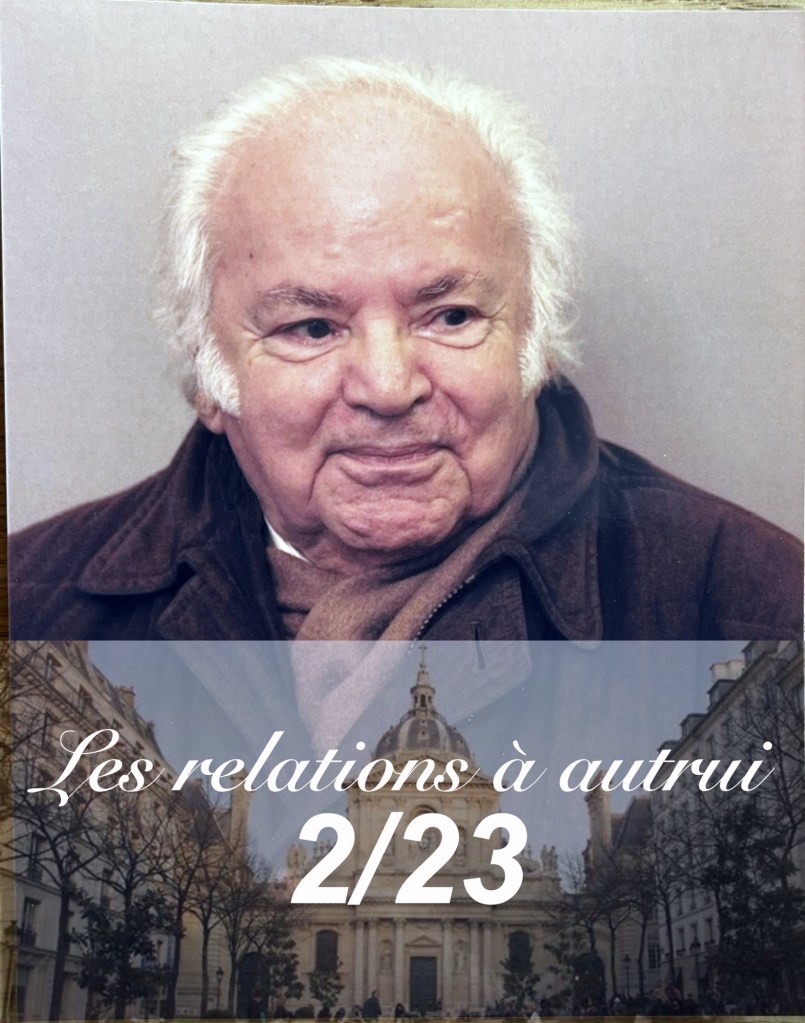Qu’est-ce que le langage ? C’est un ensemble de conventions, grammaires, syntaxes, styles, formes d’expression, langues nationales, dialectes, langues religieuses, langues profanes. D’où vient-il ? Ce que nous pouvons commencer à dire, c’est que le langage est le fruit d’une transposition de la parole, d’une organisation, d’une abstraction. Mais le langage n’est pas la parole. La parole est le moment premier de la communication, le premier moyen de la relation, ou la première expression, c’est-à-dire un moyen qui n’est pas un moyen vers une autre fin. La communication est la parole. Le langage, les médias, sont des moyens au sens technique du terme, des moyens pour obtenir un résultat. La parole n’est pas un moyen, elle est la médiation de la finalité même, la mise en œuvre, la réalisation de la finalité même. Elle est la communication. De nombreuses questions peuvent se poser : structure, finalité, signification, etc. Nous n’allons pas entrer ici dans le détail, nous évoquons seulement ces dimensions. En outre, il existe d’autres médiations de la communication : l’expression gestuelle, corporelle, le regard, le visage, etc. Il y a d’autres moyens que l’expression directe et la saisie phénoménologique directe dont nous allons parler.
J’ai voulu ici mettre l’accent sur l’idée qu’il existe une communication, mais nous voyons aussi qu’il existe tant de problèmes qu’il nous faut d’abord revenir à la question que nous posions à la fin du cours précédent : qui est l’autre ? Ici, nous sommes déjà en train de préciser cette question, de la compliquer : qui est cet autre avec lequel nous entrerons en communication quand nous parlons ?
Nous n’allons pas commencer par esquisser une réponse existentielle. Nous allons commencer par traiter le problème d’une façon technique, gnoséologique, à travers les doctrines de Husserl, Buber, Lévinas et aussi Sartre. Nous allons étudier le statut de l’autre, c’est-à-dire la nature de l’autre, même si ce mot va vite se révéler impropre.
Qu’est-ce que c’est qu’un autre ? Quelle est la structure ontologique, ou la signification ontologique de l’autre, de l’être-autre ?
Mais je voudrais auparavant ajouter quelque chose à l’idéal de la relation à autrui, qui est résumé par les mots réciprocité et transparence. Cette chose, plus difficile à définir, à cerner, ne prendra sens que lorsque nous serons en mesure de répondre à la question : qui est l’autre ? Il ne s’agit pas d’une vertu morale, mais de l’une des composantes essentielles des attitudes parfaites à l’égard d’autrui. Je veux parler de l’élégance morale. Nous évoquons par l’élégance morale une générosité, une tolérance, une sorte de respect, de tact, de délicatesse, de finesse à l’égard d’autrui. C’est l’opposé de la diplomatie, qui est faite de stratégies, de calculs, justement, tout ce que nous excluons par l’idée d’élégance morale. Pourquoi en parler ici ? Parce que la prise en compte sérieuse de l’autre est la prise de conscience du fait que l’autre est une personnalité riche et sensible, avec des valeurs, un système de jugement, une attitude à l’égard du monde. Cette élégance morale, ce tact consistent à ne pas heurter, c’est-à-dire ne pas nier, ces valeurs. Nous pourrions parler de civilité, en donnant à ce terme un sens philosophique fort. Il s’agit de respecter le lieu où se trouve autrui. La familiarité, c’est le contraire de l’élégance morale. Par exemple, le fait d’annoncer à la télévision que vous donnez 2 millions pour la recherche, c’est le contraire de l’élégance morale. L’élégance morale, ce serait la discrétion, la pudeur, l’anonymat du don.
Ici se pose à nouveau la même question : qui est donc cet autre qui mérite tant le respect, l’élégance morale, la réciprocité, la transparence ? Si j’ai commencé par décrire un peu quelques lignes de notre idéal, c’est pour nous empêcher rapidement de dire n’importe quoi sur la nature de l’autre. Nous exclurons très vite les interprétations mécanistes, parce que les questions, les problèmes de valeur que nous venons d’évoquer rapidement ne se posent pas à l’égard d’une machine.
Maintenant, nous pouvons aborder le côté technique.
Nous allons étudier l’existence même de l’autre, c’est-à-dire l’autre en tant qu’il existe comme autre. Nous n’allons pas étudier encore sa personnalité, c’est-à-dire mes relations à sa personnalité. Nous n’allons pas non plus tout de suite étudier les moyens que nous avons de connaître l’autre, c’est-à-dire de connaître sa personnalité. Si nous commencions toutes ces démarches, nous irions trop vite, nous considérerions déjà le problème comme résolu. Se demander qui est l’autre, n’est pas se demander quelle est sa personnalité, parce que si je demande quelle est sa personnalité, cela signifie que je sais déjà que c’est une conscience humaine, douée de personnalité, et je me demande laquelle. Ce serait donc trop rapide du point de vue phénoménologique, du point de vue de la rigueur de la réflexion. Nous allons nous interroger non pas sur la personnalité de l’autre, mais sur sa pure existence comme autre.
La première réponse qui vient à l’esprit est une réponse rationnelle et analogique. Celle-ci est mise en évidence par Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception, lorsqu’il critique, à bon droit, la thèse cartésienne. Dans la troisième méditation, à propos de la vérité, Descartes explique que ce ne sont pas les sens (la vue, le toucher, etc.) qui connaissent un objet, c’est l’esprit. Vient alors le fameux exemple du morceau de cire : les sens ne verraient que deux objets différents : la cire froide, la cire chauffée, et ce ne sont pas les mêmes objets. Or, un jugement vrai et juste consiste à dire qu’il s’agit du même objet : c’est de la cire. Descartes montre ainsi que seule l’âme (dans son vocabulaire) peut juger, donc connaître, mais pas les sens. De la même façon, lorsque de ma fenêtre, je vois passer des manteaux et des chapeaux, je fais un raisonnement analogique : puisque moi qui suis un être humain, je sais que je puis me déplacer avec manteau et chapeau, lorsque je vois seulement manteaux et chapeaux, de haut depuis ma fenêtre, de la même façon que mon manteau et mon chapeau sont liés à mon corps humain, sous ce manteau et ce chapeau, il y a un troisième terme identique, c’est-à-dire un corps humain. Comme pour moi, sous mon manteau est un être vivant, sous le manteau de l’autre est, conclusion, un être vivant.
C’est ce raisonnement analogique auquel fait allusion Merleau-Ponty. Il n’a pas de mal à en faire la critique, car autrui ne peut pas être le résultat d’un raisonnement analogique ou d’une déduction. En effet, devant des automates, nous pourrions faire le même raisonnement si nous ne savions pas être en présence d’automates. Avec les premiers termes, les manteaux et chapeaux, puis derrière, il y aurait, non un être humain, mais un automate, une mécanique. Il nous faut donc faire intervenir une expérience évidente, directe, disent les phénoménologues, pour prendre conscience du fait que, devant nous, l’individu est un individu humain. Quelle expérience ? Quelle expérience intuitive, immédiate, directe, et évidente ?
Nous allons entrer un peu dans le détail et pour cela, nous allons étudier Husserl, la cinquième méditation. Mais auparavant, nous allons exclure encore autre chose : non seulement autrui ne peut pas être le résultat d’un raisonnement analogique, mais autrui ne peut pas non plus être le résultat d’une connaissance, sous-entendu, d’une connaissance scientifique, c’est-à-dire, puisqu’il s’agit de l’homme, d’une connaissance anthropologique. Ici, je vais faire allusion à deux textes pour que vous puissiez vous y reporter. Un texte de Buber que nous reverrons un peu plus tard, et un autre texte de Sartre qu’il est bon de connaître. Pour essayer de mettre en évidence l’originalité de Heidegger, et plus largement l’originalité de la phénoménologie, Sartre dit dans la préface à Esquisse d’une théorie phénoménologique des émotions : pour atteindre l’homme, on ne peut pas procéder par sommation de caractéristiques objectives. Toute sommation de caractéristiques objectives ressemblerait à la vaine tentative d’obtenir l’unité en ajoutant des 9 après 0. On peut ajouter des millions de 9 après 0,9, on ne parviendra pas à l’unité. L’unité exige, dans les exemples mathématiques, un saut. De même, on ne peut pas poser qu’autrui puisse être la somme d’une connaissance anthropologique au sens scientifique, que je pourrais avoir sur lui. Par exemple, il y a de l’anthropologie au musée de l’homme, c’est l’étude de l’anthropologie préhistorique, c’est en fait de l’anthropologie physique. On étudie les squelettes humains, des crânes. On mesure longueur, largeur, le rapport entre longueur et largeur du crâne, hauteur, etc. Cette anthropologie physique est scientifique, et ne nous livre jamais l’homme, ni l’homme vivant, ni l’homme en tant que tel. Les ossements ne forment pas un homme, même si on sait classer les os, les ossements. On peut classer les ossements, et manquer l’humanité. Alors pour de multiples raisons, on peut classer aussi les caractéristiques physiques du vivant, la corpulence, la pigmentation, la forme de ses cheveux, il y a des savants qui font ça. Pour autant, on manque l’homme vivant, concret. Pourquoi ?
Il y a une insuffisance de la description même scientifique d’une chose : les caractéristiques humaines que donnent les anthropologies physiques sont toujours des caractéristiques générales. Il y a les dolichocéphales, il y a les brachycéphales. Alors, un anthropologue, qui n’est pas raciste, dira : des dolichocéphales et des brachycéphales, il y en a dans toutes les populations, il y a des mélanges, il y a peut-être quelques « en plus », mais ce n’est pas supérieur ou inférieur, dolichocéphales ou brachycéphales. Mais ça existe, c’est comme ça, voilà ce que c’est connaître l’humanité, pour le scientifique anthropologue. Or la connaissance de l’universel ne permet jamais de rendre compte de l’individu. Aristote l’a déjà dit il y a longtemps, mais on a oublié. Il n’y a de science que de l’universel, c’est-à-dire dire que abstraite. Et les humains sont des individus. La science connaît des généralités, et il n’existe que des individus. Est-ce que ça suffit pour dire que l’être humain ne peut pas être objet d’anthropologie physique ? Le fait que ce soit les individus qui existent et non les classes ou les espèces, ne nous permet pas encore d’affirmer que ces individus sont des individus humains. En réalité, il n’y a pas deux humains qui se ressemblent. Donc la science générale serait insuffisante. Mais ne pourrions-nous pas faire l’hypothèse d’une science assez riche pour cerner complètement un individu ? C’est ce que dira le scientiste : si nous avons tous les paramètres possibles, nous arriverons à décrire scientifiquement l’ensemble des lois causales qui conduisent à un individu. Donc ce n’est pas seulement la question de l’opposition universel singulier qui est en jeu.
Ce qui est aussi en jeu, c’est la question de l’opposition entre l’extériorité et l’intériorité. Entre la choséité et la conscience. Et ici, ce sur quoi nous devons insister, c’est sur le fossé radical qui existe entre une chose et une conscience. Vous pouvez donner tous les paramètres physiques qui situeraient un individu dans l’espace, dans le temps, dans sa famille, dans sa classe, etc. avec tous les déterminismes que vous voudrez, vous arriverez peut-être à situer son physique, vous n’arriverez pas à situer ce qui fait qu’il est une conscience, c’est-à-dire sa conscience qualitative, qui ne dépend pas de ses déterminismes, s’il y a déterminisme, ou détermination physique. On ne pense pas avec la forme de ses cheveux. On ne pense pas avec la couleur de sa peau. La conscience est quelque chose de tout autre, c’est-à-dire quelque chose de radicalement différent. Toutes ces idées ne sont pas contenues dans la préface de Sartre. Par contre, elles sont présentes dans le Je et le Tu de Buber.
Buber dit ceci : il y a deux manières de se rapporter à autrui. Et la première, la plus fréquente, est celle qui est exprimée par l’expression linguistique, la relation syntaxique Je – cela. Il y a une attitude dans laquelle le Je, c’est-à-dire le sujet, qui le plus souvent est celui du savant, de l’anthropologue, de l’historien, du sociologue, du psychologue, du psychanalyste. Ce Je se rapporte à autrui comme à un cela, comme un ça, comme à une chose. C’est-à-dire que le Je se rapporte à l’autre en restant à l’extérieur de l’autre, et en essayant de l’expliquer par la connaissance. L’autre a, par exemple, tel ou tel comportement en raison de tel et tel déterminisme, pense le savant : déterminisme économique de la classe où il est né, déterminisme psychologique dû à son enfance, déterminisme sociologique dû aux pesanteurs sociales, etc. L’autre est le fruit de tous ces déterminismes. Connaître l’autre, c’est connaître un cela, c’est connaître une chose. Les psychologues, les sociologues, tous ceux que j’ai nommés, ne tentent même plus une anthropologie physique, ils tentent une anthropologie humaine, ils tentent de faire des sciences humaines, nous voilà au cœur du problème. Et par les sciences humaines, ils tentent de mettre en place des systèmes de lois qui permettraient de connaître et donc de réduire l’autre à ses composantes causales.
Nous pouvons dès à présent faire la même double critique que tout à l’heure. La première critique est juste, mais elle ne va pas à l’essentiel. La seconde critique, repérée sur un champ libéré par la première critique, ira à l’essentiel.
Première critique : la sommation de toutes les caractéristiques anthropologiques qui définissent un individu, sa classe, son histoire, son passé, sa culture, etc. la sommation de toutes ces caractéristiques, sera toujours insuffisante, infiniment insuffisante et incapable de rejoindre l’unicité de la détermination individuelle, soit en terme de personnalité, soit en termes de conscience.
Deuxième critique : on reste toujours à l’extérieur. Non seulement, une somme de déterminismes ne rendra jamais compte d’une activité unique, celle d’un individu, mais d’autre part, une somme de déterminismes, chosistes et pensés en troisième personne, ne rendra jamais compte de l’intériorité d’une conscience.
Nous ne sommes pas en train de faire un raisonnement spiritualiste. Je ne suis pas en train de distinguer l’âme et le corps. Je suis en train de distinguer des méthodes de connaissance, d’une part, et de préparer un domaine où pourra se développer une description de l’humain. Parce que l’humain auquel nous allons avoir affaire sera une unité, corps-conscience, je veux dire ceci : le corps humain réel échappe aussi à la définition par la sommation de déterminismes. Le corps humain n’est pas une somme de déterminismes. Il n’est pas non plus connaissable ou réductible à la somme de ses déterminations. Sur vos cartes d’identité, sur vos papiers, vous avez des caractéristiques, frustes et approximatives. Elles ont exactement le style de détermination anthropologique inadéquate. Un individu ne saurait jamais être défini par la couleur de ses yeux. Vous avez sur toutes les cartes d’identité la couleur des yeux, comme s’il n’y avait qu’un seul individu qui ait des yeux de telle couleur. Les anthropologues font la même chose, les historiens font la même chose, ils expliquent n’importe quel événement social par une causalité antérieure, avant de comprendre : il y a tels événements parce qu’il y a telles tensions économiques. Et puis, le temps passe, les événements se débloquent et on s’aperçoit que ça n’était pas ça du tout qui était en jeu ou en cause. Par conséquent, toutes les déterminations extérieures ni ne permettent de rejoindre l’originalité d’une conscience, ni ne permettent de rejoindre l’humanité d’un corps humain. Le corps humain se définit par toutes ces déterminations dont nous avons dit tout à l’heure qu’elles entraient dans une communication : paroles, gestes, expression, etc. Or, de la parole, du geste et de l’expression, il n’y a pas de définition physique possible. Il n’y a donc pas de définition scientifique possible du corps humain.
Je résume tout cela en évoquant un texte fondamental qu’il est bon de connaître ou de regarder encore, de feuilleter un peu, un texte auquel vous pouvez donner beaucoup de place. Il s’agit de l’ouvrage de Husserl : La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Ce que Husserl fait dans les années 20, c’est d’une façon plus détaillée, plus approfondie, plus complète, plus précise, tout ce qu’on a fait ici. Il fait la critique du psychologisme et du scientisme en tant qu’ils sont incapables de rendre compte réellement de l’originalité de la conscience humaine. Et voilà pourquoi Husserl préconise justement de remplacer la science, la fausse science, par une vraie science. La vraie science, c’est la philosophie. Elle va saisir les choses de l’intérieur et phénoménologiquement. Et si l’on doit pouvoir se prononcer valablement dans les débats concrets, dans les débats historiques, dans les débats politiques, dans les débats éthiques, si l’on veut pouvoir soi-même se construire une voie, il est clair qu’il faut commencer par le commencement et avoir une méthode suffisamment rigoureuse et radicale, il ne peut s’agir que de la méthode phénoménologique.
Je vais en parler en évoquant Buber, vous trouverez également tout cela dans le Je et le Tu.
Remarquons en passant combien la philosophie, dans les années 20, posait déjà les vrais problèmes qu’on oublie maintenant, écrasés que nous sommes par le prestige des sciences humaines. Prestige tellement étonnant qu’on pourrait presque dire qu’il est de l’ordre de la religion et de la croyance. Puisque les échecs empiriques de la sociologie, ou de l’économie politique, ou de la psychanalyse, ne ruinent pas la décision de certains de faire de la psychanalyse, de l’économie politique, de la sociologie ou de l’histoire déterministe. Constamment, l’histoire réelle du monde dément l’unicité prévisible de l’histoire. Imperturbables, comme si de rien n’était, les philosophes de l’histoire continuent à parler du sens de l’histoire, du déterminisme historique, etc. L’expérience ne dément pas leur doctrine. Cela veut dire que leur doctrine est une croyance. Nous avons, au contraire, l’ambition de nous appuyer sur un savoir qui serait indiscutable, et qui serait vérifiable par l’expérience. Ce ne peut être qu’un savoir philosophique et phénoménologique. Un savoir qui est à la fois une réflexion et une confrontation constante avec le réel.
Buber évoquait tout cela en rassemblant toutes ces attitudes sous le terme d’attitudes chosifiantes et réductionnistes. Ce sont des termes simples, clairs, que vous pouvez comprendre. Il faudrait que nous nous souvenions de cela : les anthropologies, à la fois physiques ou humaines, les sciences physiques ou humaines, finalement, ont toujours pour but ou pour résultat, de faire une réduction de l’originalité humaine. Réduction à quoi ? À des éléments plus simples et mécaniques, et antérieurs. Le réductionnisme consiste à réduire le complexe au simple, le développé au non-développé et même ce qui est libre à ce qui serait déterminé. Le réductionnisme consiste à réduire la totalité vivante d’un être, d’un monde, d’une situation, à ses causes élémentaires, ou à ses éléments constituants. Comme si chaque constituant était un élément – chose en soi doué d’une efficacité causale déterminisme. Cette science est en réalité celle de la chimie, elle convient par commodité pour la chimie. Un élément complexe, l’eau, est décomposé en ses éléments, hydrogène, oxygène, et d’autres éléments, des gaz, etc. et la somme de ces éléments, ou la synthèse par stimuli électrique, permet la reconstitution du tout. Et les mêmes déterminismes ou des déterminismes nouveaux, issus de la rencontre des deux éléments déterminants permettrait de rendre compte de l’individu final. C’est vrai en chimie. La question qui se pose est justement celle-ci : cette méthode est-elle valable pour la conscience ? Nous sommes en train de voir que non. Réduire la conscience à ces éléments, c’est la trahir, la dénaturer, la méconnaître.
Citons un autre exemple, pour vous montrer que ce problème méthodologique était celui qui était au centre de tous les débats et travaux de philosophie dans les années 20 et 30. Je vais citer Jaspers. Je vous rappelle l’ouvrage important dont le titre est Philosophie qui été écrit en 1932, mais je vais évoquer un autre de ses ouvrages : Traité de psychopathologie générale. Je voudrais insister me référer à cet ouvrage, notamment pour l’introduction de la première partie, les 60 premières pages, où Jaspers développe la différence entre expliquer et comprendre. Expliquer, c’est réduire aux éléments qui sont des causes, par une analyse régressive qui va du présent au passé. C’est l’attitude générale des psychiatres de son temps, je dois dire des psychiatres contemporains aussi, pour la plupart d’entre eux : ils tentent d’expliquer. Ils développent un phénomène présent, et ils le réduisent à ses éléments composants et anciens. Jaspers quant à lui, propose à la place de l’explication, la compréhension. C’est-à-dire, non pas le développement qui écartèle, qui explique, qui développe, déplie, mais plutôt l’interprétation qui va comprendre, c’est-à-dire, prendre ensemble tous les éléments, en les éclairant, non par la causalité mais par la liberté, non par le passé mais par l’avenir. Il a tenté d’appliquer ça en psychiatrie. Il n’y a pas à expliquer un délire, il faut le comprendre, pour aider. Puis il a vu l’état de la psychiatrie, il a vu l’état de la psychologie de son temps puis il est venu aux mêmes conclusions que Husserl. Il a bien essayé d’écrire ce livre – Traité de psychopathologie générale – puis d’appliquer peu ses pensées dans son travail clinique, mais il n’y est pas parvenu. Par la suite il est passé à la philosophie. Jaspers a bien compris qu’il nous faut remplacer expliquer par comprendre.
Pourquoi ? Parce que l’individu humain n’est pas le résultat de causalités multiples, ou le réseau de déterminismes. Il est le résultat d’une intentionnalité. Il y a une intention qui préside à son activité. C’est un avenir qu’il se pose, un avenir intérieur, une pensée d’avenir, toujours une pensée qui se dirige vers l’avenir, je l’appellerai un désir, en donnant au désir, un sens dynamique, et non un sens causal. C’est un désir, c’est une intentionnalité qui anime tous les actes d’un individu, c’est-à-dire de sa conscience, et de tout son être. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie – Jaspers, Traité de psychopathologie générale, Buber, le Je et le Tu, sont donc d’accord — sans s’être consultés, parce que ce sont les tâches du temps — pour comprendre, pour poser, que la connaissance du sujet humain ne saurait être une connaissance scientifique, elle ne saurait être qu’une connaissance philosophique. Quelle est cette connaissance philosophique ? Elle est l’appréhension de la conscience de l’autre. Comment ?
Rappelons d’abord la deuxième voie dont parle Buber. Il l’oppose à la relation à l’autre en tant que Je – cela qui réduit l’autre à une chose, et qui, en fait, interdit toute communication. Je ne peux pas être en communication avec un être qui est un résultat, on ne peut pas être en communication avec une machine. Voilà pourquoi dans la psychiatrie du 18e siècle ou du 19e siècle, les malades sont des objets, pas des consciences. On les explique et en conséquence, on n’a pas de relation avec eux. On ne peut entrer en relation qu’avec un être qui n’est pas une chose, et qui n’est pas une machine. Quelle est cette relation ? Buber va la décrire en rassemblant toutes ses caractéristiques sous un mot principe symétrique du Je-cela, avec un deuxième mot principe : le Je-Tu.
Son livre s’appelle le Je et le Tu, le Tu c’est le « toi ». L’autre comme « autre » dans une relation humaine, authentiquement humaine. L’autre en général n’est saisi comme « conscience » qu’à la condition précisément de ne pas être saisi comme une généralité, de ne pas être saisi comme, par exemple, un élément d’une population, de ne pas être saisi comme le représentant d’une classe. Avoir affaire à un ouvrier ne doit pas être avoir affaire à un prolétaire travailleur. Ça doit être : avoir affaire à un untel, qui a un nom, qui a un prénom, qui a une activité, une conscience de soi. Comment opérer cela ? Uniquement par la relation Je – Tu, c’est-à-dire par la considération de l’autre comme une autre conscience. À ce moment intervient, dit Buber, le sentiment immédiat de la réciprocité. Et la réciprocité ici est un acte double, qui n’est pas un calcul et qui est dans ses éléments les plus simples, la simple affirmation réciproque que l’autre est un autre Je. En fait, le Tu est posé comme un Tu parce qu‘il est posé comme un autre Je. C’est ce que Husserl mettra mieux en forme après Buber : Le Je et le Tu date de 1923, Les méditations cartésiennes date de 1929.
Cette relation qui permet de saisir que l’autre est une conscience, est donnée dans cette médiation, cette parole qui est le Tu. On s’adresse à l’autre, le Tu est humanisant. C’est à travers cette parole, ce rapport direct, que se révèle dans l’expérience de la réciprocité l’évidence qui est en présence d’une conscience. Et cela est inexplicable, dit Buber. À la lettre, il a raison, car si on explique, on est renvoyé à la série des causes. La prise de conscience d’une conscience par une conscience est un événement immédiat et absolu. Buber parle du miracle de la rencontre. Il peut très bien se faire que ce miracle de la rencontre se fasse entre gens qui au départ ne parlent pas la même langue sociale. On peut même aller plus loin : si on est dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue, pourvu qu’on ait une attitude humaniste, une attitude de perception d’autrui, on peut très bien saisir que les autres, qu’on ne comprend pas oralement, sont des consciences. On entre en relation avec eux. Naturellement, ensuite, la relation s’approfondit par le langage, évidemment, par la parole comme on l’a vu plus haut. L’essentiel est de voir que seule une expérience immédiate, fondamentale, existentielle et phénoménologique peut rendre compte de l’originalité de l’existence de l’autre, et surtout peut nous livrer — c’est cela que nous voulions — l’évidence de l’existence de l’autre. Nous n’avons pas à faire ni à des automates, ni à des chapeaux-manteaux, ou à des portes manteaux. Nous avons à faire, c’est immédiat, la certitude est immédiate et assurée, à des consciences.
Qu’est-ce que cette expérience ? Pour Buber la réciprocité : le contact intuitif immédiat avec autrui. Il existe d’autres expériences que nous étudierons. Par exemple, celle étudiée par Sartre concernant le regard, celle étudiée par Lévinas concernant le visage, et surtout celle étudiée par Husserl : l’apperception de alter ego. L’autre est alter ego. On entrera dans le détail de cette analyse la semaine prochaine.
Robert Misrahi, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne-Paris 1 (6 novembre 1990)