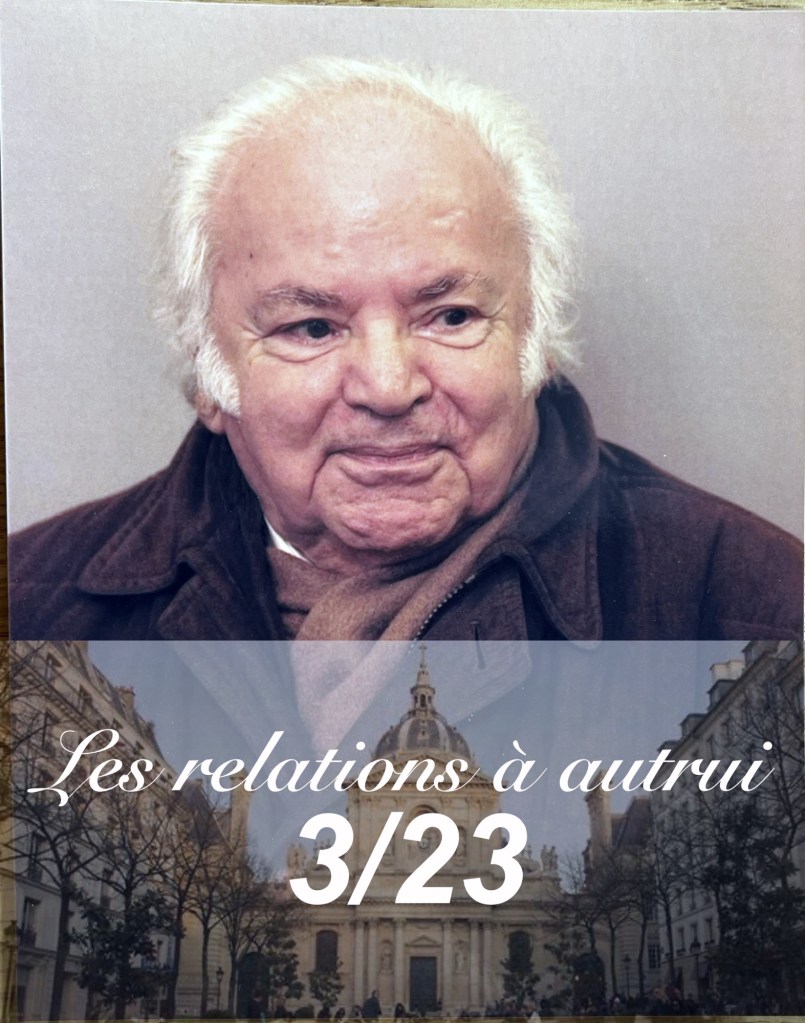Nous continuons notre travail, qui consiste pour nous tous, depuis toujours et jusqu’à aujourd’hui, à lutter contre la violence.
À présent, je veux parler de la crise selon Husserl. Il s’agit de la critique qui met en évidence cette crise, c’est-à-dire la prise de conscience des insuffisances et des contradictions des sciences psychologiques et anthropologiques. Ces sciences supposent une approche d’autrui en tant qu’objet, le réduisant à des effets de multiples déterminismes. C’est ce que font la science, la psychologie et la sociologie. On retrouve ici une idée similaire à la première attitude décrite par Buber, qui découle de ce qu’il appelle le mot-principe « Je-Cela ».
Mais avant de poursuivre sur Husserl, je souhaite évoquer un autre philosophe, sur lequel nous donnerons plus de détails plus tard, pour aborder le même point. Il s’agit de Lévinas et de ce qu’il appelle la « philosophie occidentale ». Ce point est très important, nous allons nous y attarder quelques instants.
Le concept de « philosophie occidentale » est propre à Lévinas. À mes yeux, il ne signifie rien. C’est une schématisation arbitraire. Il appelle « philosophie occidentale » toutes ces philosophies pratiquement rationalistes et intellectualistes, qui réduisent le rapport du sujet au monde, ou du sujet à l’autre, à un simple rapport de connaissance abstraite. Dans ce rapport, le sujet, c’est-à-dire la raison, se borne à réduire l’autre au même et à ne découvrir rationnellement dans le monde, ou dans l’autre, que de l’identique à soi-même.
Ce qui est intéressant chez Lévinas n’est pas le concept de « philosophie occidentale ». Je dis que ce concept est une absurdité, car il veut y inscrire toutes les philosophies qui l’ont précédé, pour les combattre, en disant qu’elles sont toutes des philosophies rationalistes qui procèdent par simple identification et appauvrissement. Un regard rapide sur l’histoire de la philosophie nous montre qu’il n’en est heureusement rien. Puisqu’il dit « occidentales », pensons aux philosophies européennes, par commodité. Qu’est-ce qu’une philosophie européenne ? Ce n’est pas une philosophie qui répond à certains contenus, ce serait absurde. Une philosophie européenne serait constituée par des philosophies extrêmement diverses, qui ont vu le jour dans une région appelée l’Europe, et qui peuvent être aussi différentes que la philosophie de Saint-Jean de la Croix ou celle de Kant. C’est aux antipodes. La philosophie de Georges Bataille, contemporaine ou presque, et la philosophie de Descartes, c’est aux antipodes. La philosophie de Kierkegaard et celle de Leibniz, c’est aux antipodes. Il est absurde de parler d’une philosophie occidentale qui aurait un certain nombre de déterminations internes. On peut employer le terme « philosophie européenne » si on veut, à condition de montrer qu’elles sont toutes diverses, toutes différentes. On pourrait rapprocher telle ou telle mystique née en Espagne de telle ou telle mystique née au Moyen Âge en Irlande. On pourrait rapprocher les rationalistes du Moyen Âge en Espagne des rationalistes de la même période à Paris, ils sont rares, ils ont tous été jetés en prison ou assassinés. Mais laissons ces absurdes schématisations.
La « philosophie occidentale » est donc un concept absurde, polémique, vide. Pourquoi l’évoquer ? D’abord parce que tout le monde se réfère à Lévinas, et aussi parce que derrière cette absurdité, il y a une idée juste. Il convient, laisse entendre Lévinas, que dans le rapport à autrui comme dans le rapport au monde, nous nous référions autant à la différence qu’à l’identité. Il nous faut être plus conscients de la différence, soit entre les éléments du monde qui ont une importance, soit entre ces éléments et nous. Il faut être conscient de la différence et de l’altérité. L’idée intéressante de Lévinas, son noyau central, est ceci : se rapporter à autrui ne devrait pas consister à se rapporter à un autre moi-même. Trop souvent, se rapporter à autrui n’est que se rapporter à un autre soi-même, c’est-à-dire faire de l’autre son propre moi, s’admirer soi-même dans l’autre, feindre d’admirer l’autre quand on n’admire que soi, croire connaître l’autre et ne connaître que soi, ne connaître que celui qui est identique à soi, réduire l’autre à soi-même. En fait, c’est là une reprise dans des termes philosophiques d’une vieille idée fondamentale, que partagent tous les philosophes : il s’agit d’éviter, dans la relation à l’autre, le narcissisme, c’est-à-dire se rendre aveugle à la spécificité de l’autre. Éviter l’écueil de voir en l’autre que ce qui est identique à nous, et de vouloir réduire l’autre à nous, quitte à condamner en lui ce qui ne serait pas identique à nous. Au fond, c’est la source du racisme, de rejeter la différence et de n’admettre que l’identité. Tout ce qui n’est pas identique est condamnable. Nous voyons bien chez Lévinas que le rapport à autrui doit être le rapport à un sujet qui n’est pas nous-mêmes et qui est radicalement autre.
Que ce soit dans la critique husserlienne de l’anthropologie, dans la critique lévinassienne d’une philosophie de l’identité, ou dans la critique bubérienne d’une attitude chosifiante, nous voyons que ces trois philosophes sont d’accord pour mettre en évidence le fait que la relation à autrui est un acte tout à fait spécifique, qu’il va nous appartenir de décrire. Cet acte spécifique ne peut pas entrer dans les catégories de la science, ni dans les catégories de la rationalité identificatrice et abstraite.
Pour éviter la difficulté, certains philosophes, comme Jaspers et Lévinas, posent un moi-sujet en invoquant l’individu. L’individu, c’est la même chose que le sujet, mais ce sujet est néanmoins un moi. Je résume ce problème en quelques phrases, avant d’en arriver à l’analyse bien spécifique et particulière de Husserl. S’il est vrai que pour se rapporter à autrui, il ne faut pas le réduire à une chose ou à un objet de connaissance scientifique, cela signifie qu’il faut reconnaître en autrui un sujet. Très vite, certains philosophes identifient imprudemment un individu humain – une conscience – et un moi, notamment Jaspers dans Philosophie, son grand travail de 1932, mais également Lévinas dans ses travaux. Ils écrivent un terme pour l’autre, parfois les deux termes avec un trait d’union, parfois un seul des deux termes : moi-sujet ou sujet-moi. Ici, le vocabulaire est extrêmement dangereux, et comme nous travaillons dans le domaine philosophique, nous travaillons dans le domaine de la rigueur lexicale : il faut donner aux mots un sens rigoureux. C’est pourquoi je propose dès maintenant que l’on distingue bien moi et sujet, et on comprendra mieux la suite des analyses des autres philosophes, notamment Buber et Husserl.
Qu’est-ce que le moi ? En fait, le moi désigne ce que dans le langage ordinaire on appellerait caractère, personnalité, affectivité, ou déploiement concret, singulier d’une affectivité singulière, ou d’un caractère singulier, d’une personnalité. Le moi est l’ensemble des forces affectives qui jouent en nous, et qui nous caractérisent. Le moi est surtout fait de passions et d’affectivités, de goûts, d’options. Le moi est presque une chose en train de se faire au cours du temps en nous, et puis qui cristallise et ensuite on a un moi. Parfois le moi est « profond », celui-là on le sauve, et parfois il est « superficiel », celui-là on le condamne. Or, n’oublions pas que ce mot est un pronom, c’est un complément d’objet. Je peux dire : je me pense, je me réfléchis. Quand je réfléchis, je réfléchis à ce que je fais, ce que je pense, ce que je pensais, je me pense. Alors radicalement, si je me pense, c’est que je pense un moi. Je, c’est la conscience et moi, c’est l’affectivité. Quand je dis « je me pense » ou « je pense moi », « je réfléchis à moi » ou « je me préoccupe de moi », je ne dois pas être victime de la syntaxe, et chosifier un pseudo-corrélat d’un simple pronom complément. « Je pense à mes actes » ou « Je pense à ma conscience », « Je pense à ma personnalité » ne peut pas vouloir dire « je pense moi » : je pense comment ça se déroule en moi, j’élucide les mécanismes du moi, les mécanismes d’agression du moi, les mécanismes de défense du moi. Sur l’archange de la passivité linguistique, on en arrive à de la psychologie empirique qui invente son objet : le moi avec ses lois, ses forces, ses mécanismes, etc. On a inventé le moi. Sartre l’a très bien montré dans La Transcendance de l’ego : on chosifie le sujet en le réduisant à l’état de moi. Il faut comprendre que ce pseudo-moi en l’autre est une invention, c’est ici l’une des idées justes de Sartre. Et même les philosophes avertis, qui sont soucieux de ne pas chosifier autrui, oublient qu’il faut dans le même temps ne pas chosifier le sujet qui ne veut pas chosifier autrui. Si on ne doit pas chosifier autrui dans le rapport de nous à lui, il ne faut pas non plus laisser autrui se chosifier lui-même, ou être chosifié par les sciences humaines, qui vont déceler en lui un moi, avec des lois, des mécanismes, un devenir, des influences, des forces, des réactions, etc., bref, en faire un objet psychophysique ou chimique ou biochimique.
Il sera essentiel, au contraire, d’avoir une conscience très vive de la spécificité du concept de sujet. Le sujet est là, en première personne, une conscience qui peut dire « je », qui est identique à soi et en même temps active. Et tout individu est un sujet. Et non pas un sujet-moi ou un moi-sujet. Cela ne signifie pas que tous les individus soient identiques, mais cela signifie que ce qui fait la différenciation des individus n’est pas un moi. C’est une personnalité, un système de pensée, un système de foi, un système de valeurs, une histoire vécue, une histoire assumée, etc. Tout cela s’appelle une individualité. Mais elle n’est pas le fruit passif des mécanismes scientifiques, déterministes, qui se déploieraient dans une espèce de chose psychique. Ne confondons pas le sujet avec une chose psychique. Ici, n’hésitons pas à citer encore Sartre qui, sur ce plan, a raison. Sartre montre bien que trop souvent dans la réflexion nous transformons l’intériorité, l’en-soi, en psyché. Mais la psyché – pour reprendre son vocabulaire, c’est-à-dire le moi, celui que je vous ai décrit, la personnalité affective – est, dit Sartre, un en-soi. Ça se résume comme une chose, cette chose est en nous. On doit tenir compte de notre moi, de notre psyché. Mais la psyché, arbitrairement et rétroactivement inventée, je ne dis pas les sentiments, je ne dis pas les actes, je ne dis pas les valeurs. Ceux-là sont toujours en actes. Mais ce qui serait la pesanteur passive et impersonnelle d’un moi est un inventé a posteriori. Dans le style d’explication qui consiste à dire, comme on le voit dans les mauvais romans : il fit ceci parce qu’il était cela… mais puisqu’il était ceci, alors il a agi selon… etc. Nous sommes ici face à un déterminisme quasiment psychoconscient. Le déterminisme qui va du moi à la conscience. Et quand on ne voit pas très clair les liens, on va dire que le moi est inconscient. D’abord on l’invente puis on le met à l’ordre. C’est commode, on peut lui faire dire absolument n’importe quoi. La lucidité phénoménologique exige, au contraire, qu’on s’aperçoive que toute la conscience doit être transparente à la vie. Si elle travaille, si elle est courageuse devant elle-même, bien entendu.
Maintenant, nous allons utiliser un exemple en philosophie qui va répondre à toutes les problématiques que nous venons de poser, c’est-à-dire décrire l’expérience d’autrui en rendant justice à la spécificité d’autrui comme tel, et à la spécificité de l’expérience d’autrui. Il s’agit de la phénoménologie.
D’abord, quelques matériaux nécessaires pour savoir mieux ce qu’est la phénoménologie. Vous pouvez lire d’abord l’introduction de L’Être et le Néant, de Sartre. Ensuite, il est bon de lire très attentivement, parce qu’elle est remarquable, l’introduction de La Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui décrit bien ce qu’est la phénoménologie de Husserl. Vous pouvez utiliser aussi les tout premiers travaux de Lévinas sur Husserl, L’Intuition dans la philosophie de Husserl, par exemple, ou encore En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Et surtout, voici l’ouvrage principal que je vous conseille, un peu austère, mais solide, sérieux, où l’on apprend des choses sur Husserl, c’est Le Cogito dans la phénoménologie de Husserl, de Gaston Berger. Il y a une note de Ricœur à la traduction qu’il a faite de l’ouvrage principal de Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures. Dans ce texte, il y a des notes de Ricœur qui sont excellentes. Toutes ces sources vous permettront de mieux cerner ce qu’est la phénoménologie et surtout ce qu’en dit Husserl.
Sur la base de ces réflexions, nous pouvons retirer un premier enseignement, préliminaire, introductif : désormais, la philosophie ne peut pas penser rendre compte du monde en réduisant le monde à des éléments scientifiques matériels antérieurs. La phénoménologie doit décrire complètement les significations qui se déroulent dans la conscience de celui qui perçoit, c’est-à-dire dans la conscience du philosophe qui réfléchit sur ce que perçoit la conscience. Il faut décrire minutieusement en l’explicitant, parce qu’il y a de nombreuses significations qui sont présentes mais enveloppées. Prenons l’exemple élémentaire de Husserl : quand je perçois un objet matériel, je sais – même sans le toucher, j’imagine – que cet objet matériel est résistant. Je le perçois, et dans la perception j’implique l’idée que toute couleur est étendue : s’il y a couleur, il y a espace, s’il y a espace, il y a couleur, c’est une implication de l’évidence immédiate, même si je ne l’ai pas dit, même si je ne l’ai pas nommé. La perception est plus riche que ce que nous en disons spontanément.
La phénoménologie va décrire cela, elle va dire par exemple que percevoir le monde, c’est forcément le percevoir avec des couleurs et du sens. Tout cela est explicitable et évident, et non pas à déduire. Il ne s’agit pas de déduire et d’expliquer, mais de décrire et d’expliciter, si l’on veut des bases solides pour une connaissance philosophique digne de ce nom. Parce que expliquer, c’est en fait interpréter, c’est inventer : inventer des causes, des raisons. Pourquoi s’est-il passé cela ? En raison de telle ou telle cause, mais on n’est pas présent face aux causes, donc on les invente. C’est comme ça que font les psychologues, ils savent tout expliquer après, avec des éléments qu’ils retrouvent, qu’ils travaillent à la louche, par rapport à la mémoire. Après, ils retiennent seulement du passé les éléments qui vont leur permettre, croient-ils, de rendre compte du présent, faits d’ailleurs qu’ils n’auraient jamais prévus s’ils s’étaient formés à décrire le passé jadis. La phénoménologie substitue la description minutieuse mais évidente à l’explication pseudo-causale et arbitraire, et rétroactive.
Alors maintenant appliquons cela à autrui.
Husserl, dans la 5e Méditation, nous donne les grandes idées qui vont nous concerner. Tout d’abord, autrui est bien l’objet d’une sorte de perception analogique, mais pas d’un raisonnement d’analogie. Vous vous souvenez, nous avons fait la critique du raisonnement d’analogie, en songeant à Descartes critiqué par Merleau-Ponty. Alors maintenant, il est temps d’accéder directement à ce sujet qu’est l’autre. Nous sommes en présence d’une aperception, en un mot aperception, une préemption analogisante. Je saisis dans l’immédiat de l’autre un autre comme moi, un humain. Et ici, je donnerais plutôt raison à Husserl qu’à Lévinas. Nous pouvons, sur un certain temps logico-moral, dire qu’il faut reconnaître dans les autres leurs différences, respecter leurs spécificités évidemment, ça tombe sous le sens philosophique, mais c’est après, c’est un acte second. Cette reconnaissance n’est possible que si d’abord on sait qu’on a affaire à une conscience humaine. Car de quelle différence s’agit-il ? Il ne s’agit pas de la différence entre nous, conscience humaine, et un arbre ou un rocher. Nous n’allons donc pas dire que l’autre homme, l’autre conscience humaine, soit quelque chose de radicalement différent, comme le prétend Lévinas. C’est sur la base d’une identité profonde que l’on peut exiger que l’on respecte ces façons différentes d’exister, sachant que chacun nous invente des manières concrètes d’exister. Mais qu’est-ce qu’il y a à la base ? La phénoménologie recherche toujours le fondement, la base, la condition de possibilité, le ce sans quoi, qui est d’abord de percevoir en l’autre une conscience. Mais percevoir en l’autre une conscience consiste en une première étape à percevoir en l’autre une conscience comme la mienne. Comme je suis un humain, l’autre est humain. Et il s’agit d’une aperception immédiate.
Husserl poursuit la description et il va découvrir que ce qui est perçu, bien sûr, c’est un autre comme moi, un ego, mais à la place duquel je ne suis pas, ou qui n’est pas à ma place. L’autre, de manière certaine, est une conscience comme moi – c’est une aperception évidente – mais il y a une deuxième évidence contemporaine de la première, c’est la même évidence : l’autre qui est une conscience est une autre conscience. C’est une conscience comme moi, mais autre. Autre en quel sens ? Dans un sens extrêmement précis. Pas dans le sens qui consisterait à dire « chacun sa spécificité, l’autre a une personnalité ». Non, il ne s’agit absolument pas de cela. Laissons toutes les déterminations empiriques de l’historicité personnelle, de l’individualité, de pseudo-caractère, de côté. L’autre est une conscience. Et qu’est-ce qui fait la différence ? D’abord l’espace, et donc le corps, ce que moi j’appellerais plus clairement, mais grâce aux analyses de Husserl : la centralisation inverse. Dans l’aperception d’autrui, on est conscient qu’autrui est une conscience qui est en elle-même son centre, centre au centre duquel je ne suis pas, et autour duquel s’organise la perception. La perception du monde s’organise pour moi autour du centre que je suis, ego, et s’organise pour l’autre autour du centre qu’il est. Il est alter ego, un autre « je ». Et comme il s’agit de l’aperception d’autrui, l’autre est en face de moi. Ce qui veut dire que la direction de nos intentionnalités est symétrique mais inverse. Je le perçois, il me perçoit. Je le perçois à partir de moi, c’est-à-dire à partir du je, mais il me perçoit à partir de lui. Il me perçoit à partir d’un centre où il est, et où je ne serai jamais. L’aperception d’autrui est en même temps la prise de conscience d’une présence évidente, non intuitionnable comme je, mais intuitionnable de l’extérieur comme autre je. C’est-à-dire que, sans jamais pouvoir être à la place de l’autre – c’est ce qui fait que je le reconnais comme conscience – je sais pourtant d’évidence que c’est une conscience, qui se dirige vers moi comme moi vers elle.
Il y a donc une aperception évidente de ce qu’on pourrait appeler une réalité non intuitionnable par moi. Cette aperception est en même temps une présentification. C’est-à-dire que je me représente l’autre, ou plutôt je le présentifie, je rends l’autre présent. Je le saisis dans sa présence et je saisis sa présence, face à ma présence. Et sa présence, je la saisis comme évidence. Cette aperception, Husserl l’appelle l’accouplement. Le véritable accouplement, c’est celui-là : la prise de conscience immédiate et évidente de la présence personnelle face à nous de l’autre, à la fois en tant qu’il est comme moi et différent de moi, en un lieu où je ne serai jamais. Mais Husserl n’a pas l’intention de décrire ici un drame. Si je sais que je ne serai jamais à la place de l’autre, heureusement, c’est plein de positivité pour l’autre, et pour moi, chacun étant lui-même. Si je devais à un certain moment avoir une illusion d’être à la place de l’autre, c’est-à-dire d’être l’autre, de m’identifier totalement à l’autre, alors à ce moment, on procéderait tout simplement à un acte symbolique. La relation identificatrice totale à l’autre est une relation amputatoire, c’est-à-dire qu’on mange l’autre, on se le dévore, on l’absorbe, on le dissout, on le supprime. Ça, c’est une relation fausse à autrui, c’est une relation mystique, celle que va critiquer Buber. La vraie relation à autrui, celle qui permet la réciprocité, la transparence, l’amour, l’amitié, est celle qui pose deux consciences, distinctes et en relation. Distinctes, c’est-à-dire qui se confèrent chacune à l’autre une réalité claire. C’est pour comprendre cela qu’il faut lire attentivement ces pages de Husserl sur l’aperception d’autrui. Le fait qu’il y ait un domaine non-intuitionné n’est pas un manque, mais une implication évidente de la souveraineté de l’autre, qui est sujet. C’est parce que l’autre est sujet – et un sujet qui est un centre – que je n’ai pas à être à sa place. Je pourrais avoir l’ambition imaginaire d’occuper cette place, mais je dois au contraire me retirer de cette place, pour lui laisser la place, la place qu’il assume, puisqu’il est un sujet.
Dans la vie quotidienne, les actions étant le plus souvent commandées par l’imagination ou la facilité, c’est le contraire qui se produit. Mais là, nous abordons déjà le problème éthique dont nous parlerons plus tard. Je ne veux pas trop anticiper. Remarquons seulement par exemple que Spinoza fait déjà cette critique en disant : dans la vie empirique, dans la vie imaginative, chacun ne cherche qu’à imposer ses vues et à faire que l’autre vive selon son propre caractère, sa propre personnalité, au lieu de le laisser vivre selon sa personnalité.
Ajoutons une chose : cette présence de l’autre est la présence de l’autre en chair et en os, ce sont les mots de Husserl, c’est-à-dire que c’est une présence incarnée, réelle et concrète. Mais vous voyez le paradoxe, ce qui est présent en chair et en os, c’est la conscience de l’autre. C’est-à-dire qu’à travers le corps réel de l’autre, est évidente la présence d’une conscience, qui est avec nous. Tout cela n’est possible évidemment que si l’on est capable d’opérer une description phénoménologique du corps de l’autre, c’est-à-dire que c’est un corps humain signifiant, et pas un système de mécanismes biologiques.
Comment communiquent ces consciences ? Et bien, deux mots seulement : d’abord par l’évidence des significations, perçues dans la corporéité et dans la présence de l’autre, et ensuite par le langage. C’est le langage qui va créer le lieu commun, la communauté des deux ou plusieurs consciences. Et c’est le langage qui, sur la base des différentes consciences, va créer une culture commune. La culture est ce monde commun qui repose sur le ou les langages pratiqués par des centres différents. Il y a une communauté entre ces consciences.
Outre la présence en chair et en os de cet alter ego, il y a un autre fait sur lequel nous pouvons insister : c’est la critique du solipsisme. Husserl, constamment, opère une critique du solipsisme. Il commence dans la 5e Méditation, puis souvent il répète cela : le fait que la conscience ego ne puisse pas intuitionner la conscience alter ego ne sépare pas les consciences. Ce n’est pas là une base réelle pour une séparation des consciences. Ça pourrait être une base illusoire, on y reviendra plus tard, mais ce n’est pas une base réelle, parce que la non-intuitionnalité d’autrui n’empêche pas l’évidence d’autrui, et n’empêche pas non plus que ce qui est l’autre sujet n’est pas un mystère, puisque chaque sujet peut s’exprimer à travers le langage métaphorique, quotidien, littéraire, artistique, direct, indirect, etc. Il y a 1000 façons d’exprimer justement la personnalité mise en œuvre par le sujet. Par conséquent, le fait de dire que chaque conscience est un centre, en lieu duquel ne peut pas être une autre conscience, cette affirmation n’est pas une affirmation négative solipsiste, à la façon de Leibniz.
Les premiers existentialistes, les contemporains de Sartre, disent : on est séparés, les consciences sont séparées, je ne peux pas vivre à la place de l’autre, je serai seul à mourir, je suis seul à naître, je n’ai pas demandé à naître. Nous essayons de dire autre chose du langage : la réciprocité, la lente construction d’un monde commun, c’est cela que nous attendons de notre réflexion.
Je reviens sur le mot accouplement utilisé par Husserl. Il n’y a pas, ni chez Husserl, ni chez Buber, l’idée selon laquelle la sexualité, c’est-à-dire l’accouplement sexuel, serait la condition préalable à toute relation à autrui. Ça serait un contre-sens monumental, c’est même exactement le contraire. Par le mot accouplement, j’ai l’impression que Husserl veut dire ceci : il y a un mot du langage ordinaire qui est accouplement. On l’emploie à tort et à travers, semble dire Husserl. La véritable signification, ou si vous voulez, la condition préalable à tout véritable accouplement charnel, c’est la prise de conscience de l’accouplement de consciences. C’est-à-dire la présence de l’autre. C’est la condition sine qua non, par exemple, d’une relation positive, amitié ou amour, il faut avoir affaire à l’autre lui-même. Pas à l’image de l’autre, ou à un semblant de l’autre, mais à l’autre lui-même. C’est cela qu’il veut dire, je crois, nous aurons l’occasion de parler plus en détail plus tard.
Allons un peu plus loin.
Un article de Derrida dans L’Écriture et la différence (un livre sur la phénoménologie), ou bien c’est dans son ouvrage La Voix et le phénomène, soulève une idée intéressante : la voix est importante. Mais l’idée finit par devenir fausse, parce que derrière la voix il faudrait aller vers un noumène, dit Derrida (car Derrida est lévinassien). La voix nous mènerait vers un noumène, un au-delà de la conscience empirique manifeste. Là, je ne le suis pas du tout. J’insiste cependant sur le phénomène de la voix : nous pourrions dire de la voix exactement ce que Husserl dit de la présence, ou ce que Scheler et Merleau-Ponty disent du corps, à savoir : devant un corps, ou devant une voix, ou devant un visage, un regard, devant tous ces phénomènes, nous avons le sentiment évident que nous ne sommes pas en présence de choses, mais en présence de significations, animées de l’intérieur par une intentionnalité vivante. Le corps, le visage, les gestes, la voix, le regard, etc. tout cela est signifiant. Et signifiant immédiatement, c’est cela qui est important : nous n’avons pas affaire à des médiations, ce ne sont pas des instruments de communication. Il ne faut pas considérer par exemple la voix, les gestes, l’expression comme des instruments, comme des médiations, comme des matériaux électroniques, comme des codes, insignifiants en eux-mêmes, mais qui par leur agencement et par des décisions conventionnelles permettraient de reconstruire l’idée lancée par un émetteur – lui, inaccessible. Il y aurait l’émetteur inaccessible, la conscience, l’âme, qui à l’aide d’instruments extérieurs, enverrait des signaux, pour dire ce qu’il a à dire. Et les signaux, ça serait le langage ou la voix. Non. Ce serait de l’anthropologie, et elle est erronée. Il nous faut au contraire, avec les phénoménologues, Husserl, Scheler, Buber, Merleau-Ponty, reconnaître que tous ces éléments que je viens de nommer sont immédiatement signifiants et signifiants d’eux-mêmes, pas signifiants d’autre chose. Ce qui est signifié, c’est eux-mêmes, c’est le signifiant qui signifie. Mais ce qu’il signifie, c’est lui-même. Le signifié, c’est le signifiant. Ce que dit un sujet vivant, c’est sa présence. Et sa présence, elle est sa présence. Elle n’est pas un système de corps, un corps, un système posé, un système de signes, devant permettre de passer à un autre domaine. Sinon, on entre dans une régression infinie, et on peut faire la critique du troisième homme qu’Aristote faisait à Platon. Si tous les signes extérieurs ne sont que des signes qui doivent couronner une conscience interne, quand vous aurez accès à la conscience interne, qu’est-ce qui vous prouve que vous avez accès à cela qu’il l’a produite ? Il faudrait remonter à cela qu’il l’a produite et de proche en proche, vous n’arrêteriez jamais et on ne pourra s’arrêter que devant Dieu. C’est ce que font les métaphysiciens. Au contraire, un phénoménologue authentique doit être athée. L’être c’est le phénomène. Et pas phénomène au sens de Jung – phénomène tragique et sans consistance. Non. L’être c’est le phénomène et le phénomène est le phénomène. Ce qu’on voit, c’est ce qui existe. Ce qui existe, c’est ce qu’on voit. Mais tout ce qu’on voit, pas une partie de ce qu’on voit, ni avec une vue déformante. Tout ce que nous voyons, c’est cela la réalité.
C’est ce que dit Merleau-Ponty qui a bien étudié Husserl mais il va au-delà, Husserl est encore bien plus préoccupé par une phénoménologie de la connaissance, mais il est sur la voie de la phénoménologie intégrale. Notre but c’est une phénoménologie intégrale.
Robert Misrahi, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne-Paris 1 (13 novembre 1990)