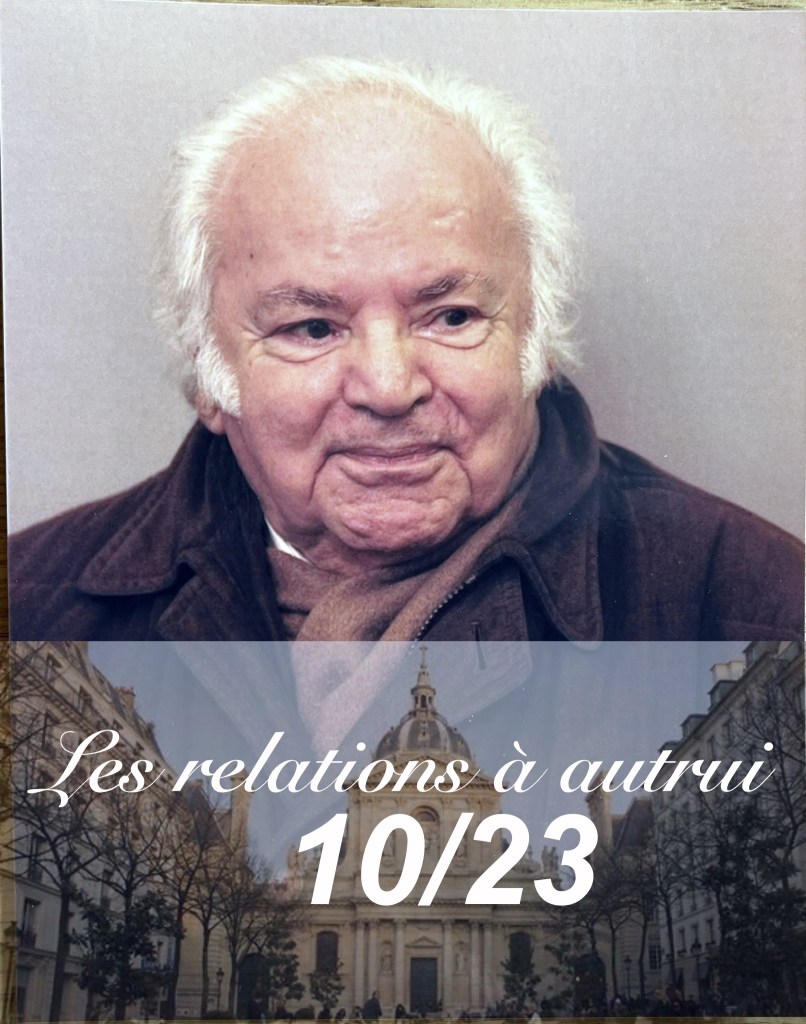Nous avons étudié différents a priori dans la doctrine de Lévinas, nous avons vu qu’il a une certaine conception du sujet, et que derrière cette conception du sujet, il y a une certaine conception de l’être. C’est important à savoir pour comprendre le sens de sa doctrine. Il est des auteurs comme Kant ou Lévinas, qu’on ne peut pas comprendre si on ne relie leur métaphysique et leur morale. Nous savons que la métaphysique de Lévinas est introduite par une référence préférentielle aux textes talmudiques, plus même qu’à la Bible. Et nous avions montré que, au fond, la théorie était elle-même a priori, c’est à dire que, de manière archaïque et sans démonstration, elle procédait à une identification du moi et du sujet, puis du moi et de la vitalité. Tout cet enchaînement s’appuyait en réalité sur un choix préférentiel premier qui est : la sacralité des écritures. Maintenant nous allons voir que, derrière ce choix a priori de la sacralité des écritures, il y a un autre choix a priori qui est une certaine doctrine de l’être. C’est ce que nous allons mettre en évidence.
Remarquons-nous tout d’abord à propos de l’ontologie, qu’elle est partout présente, malgré une apparente négation initiale.
Au départ, Lévinas semble s’opposer à une philosophe qui consisterait à privilégier la connaissance, par conséquent la connaissance de l’être-conscient, puis qui ferait par suite dépendre la morale de l’ontologie. Lévinas l’appelle « philosophie occidentale », nous avons fait la critique de l’amalgame créé par ce pseudo-concept, que Lévinas combat. Pour lui la morale est un fait premier, qui ne peut pas dépendre d’une philosophie de l’être. Selon Lévinas, les éléments les plus importants sont au-delà de l’être. D’ores et déjà nous voyons une première contradiction, indépendamment des a priori : Lévinas propose une philosophie l’être, qui elle-même va être décrite comme étant au-delà de l’être, au delà de l’opposition de l’être et du non-être. Bref, nous sommes en présence d’une ontologie de la séparation selon les mots de Lévinas.
Insistons un peu.
Cette ontologie de la séparation est exprimée dans Totalité et infini dès la page 75. Sa philosophie est hostile à une conception du monde et de l’être qui procéderait par identification, qui identifierait le monde à soi, c’est-à-dire le même au même. La philosophie de Lévinas est une philosophie de l’autre, mais en un sens métaphysique. L’autre est vu en tant qu’altérité radicale : ce qui n’est pas moi, le « non-moi ». Il s’oppose à une philosophie de l’être qui procèderait par l’identification du monde à moi-même. Il s’oppose aussi à une philosophie de l’être qui serait fondée sur une nostalgie, c’est-à-dire sur le désir de retrouver une identification de l’individu avec la totalité, comme chez Platon.
Que cherche-t’il à mettre en œuvre ? Il s’agit de fonder une ontologie de la séparation. Qu’est-ce à dire ? Il souhaite que cette ontologie, cette philosophie insiste sur la différence radicale, et non pas sur l’identité. L’identité selon Lévinas empêche de connaître en réalité. Il souhaite plutôt qu’on insiste sur la différence radicale entre ce qui n’est pas moi et ce qui est moi. Sous la plume de Lévinas, la conscience est séparée de l’absolu. En effet, puisqu’elle elle relève du fini, elle est séparée de l’infini, mais radicalement, parce que l’infini ne peut pas être simplement une prolongation ou un prolongement du fini. L’infini doit être quelque chose de complètement différent, quelque chose de Tout-Autre , comme le nomme Lévinas un autre texte. Le Tout-Autre pour Lévinas, c’est l’absolu, l’infini, complètement différent de la finitude, finitude qui par conséquent est séparée.
Cette doctrine de la séparation est également à l’oeuvre sur le plan psychologique.
L’individu est séparé de l’autre. Lorsque l’individu perçoit l’autre, si vraiment il perçoit l’autre, il doit le percevoir comme autre, comme radicalement autre et pas comme même, pense Lévinas. La conscience est donc non seulement séparée de l’absolu, mais elle est aussi séparée de l’autre. Nous pourrions même dire que la conscience est séparée d’elle-même. La vraie conscience responsable, la conscience éthique, doit en effet être séparée du moi vital. Seule la séparation, pense Lévinas, permet de comprendre la liberté et la responsabilité. On ne voit pas trop comment, mais c’est l’affirmation de Lévinas. Qu’il s’agisse du Tout-Autre c’est-à-dire de l’absolu, ou qu’il s’agisse de l’autre conscience, seule la séparation permet la prise en considération d’autrui, la reconnaissance de sa liberté, autrement dit le respect d’autrui et toute la morale que nous avons évoquée. Donc toute la morale repose pour Lévinas sur une ontologie qui est celle de la séparation, et même sur une psychologie, sur une philosophie de l’existence qui est celle de la séparation.
Il nous faut insister.
Le concept de séparation doit être pris au sens fort, et non pas au sens quasiment métaphorique de distinction. Si Lévinas parlait de distinction de moi et de l’autre, là nous serions d’accord. Pour que l’individu puisse reconnaître l’autre et se porter responsable de cet autre, ou bien apporter une aide à cet autre, le reconnaître dans ses droits et sa liberté, il faut naturellement que cette autre soit lui-même et non pas moi, il faut qu’il soit distinct. Si on n’est pas précis sur le terme, on risque de dire : il faut que l’autre soit distinct de moi, séparé de moi, de la même façon que ce dossier là devant moi. En réalité il n’est pas séparé de moi, il est distinct de moi, mais j’ai bien un lien avec ce dossier. Pour autant Lévinas utilise le mot séparé. Il y a chez Lévinas dans ce mot une charge existentielle de négation. Et en effet, très souvent, Lévinas dit ceci : on doit être responsable de l’autre en tant que l’autre est un étranger. C’est parce que la Bible dans les textes nous dit que nous avons été étrangers, que nous avons à respecter l’étranger.
Poursuivons, en remarquant que la distinction est bien la condition de la relation positive à autrui, mais à une condition technique : c’est qu’il y ait réciprocité. Pour que je puisse commencer à reconnaitre l’autre dans sa personne et ses droits comme sujet, il faut premièrement qu’il ne soit pas moi. L’autre est autre moi, comme nous le dirait Husserl, mais c’est lui et non pas moi. Mais il y a une deuxième condition, c’est la réciprocité. Il faut qu’il y ait équivalence des deux mouvements inverses de moi vers l’autre et de l’autre vers moi. S’il n’y a pas équivalence, si il n’y a pas réciprocité, comment pouvons-nous penser l’autre ? En réalité, la réciprocité est la modalité évidente, existentielle de l’identité. Mais quand j’affirme l’identité des consciences, je n’affirme pas l’identité de leur personnalité singulière vivante, ni de leurs valeurs particulières, j’affirme l’identité de leur être-conscience humaine et de leur valeur en tant que toute conscience a une valeur. Il faut que je reconnaisse l’autre comme un même que moi, dans un mouvement de réciprocité. Or, chez Lévinas il y a négation de la réciprocité, au bénéfice de l’autre. Il combat l’égoïsme, et il croit qu’on combat l’égoïsme par l’aveuglement altruiste. Au bénéfice de l’autre, on doit se soumettre à l’autre et à sa force, qui vient en première analyse de l’autre, et en seconde analyse du Tout-Autre, c’est à dire de l’absolu en moi qui me donne force et commandement.
La séparation s’appuie donc sur une sorte de dissymétrie du consentement facile. Le sujet n’est plus constituant, il n’est plus qu’obéissance. Obéissance à quoi ? Au commandement venant de l’autre, mais tout cela en relation à l’absolu, duquel je suis séparé, mais qui m’inspire.
C’est l’absolu qui m’oblige à obéir, jusqu’à partir en guerre car nom de l’absolu, on part en guerre, voyez le XVIème siècle en France. Ainsi donc, la séparation humaine a, chez Lévinas, une signification ontologique. Il faut accepter cette séparation humaine parce qu’elle est en somme le reflet de la séparation d’avec l’absolu, et comme il s’agit de réaliser les ordres de l’absolu, il faut assumer cette séparation. D’ailleurs dans Totalité et infini nous pouvons lire page 276 : « Dans l’accueil de l’autre, j’accueille le Très-Haut ». C’est Lévinas qui parle, c’est la phrase d’un philosophe de la modernité ! Cette phrase est d’un archaïsme consternant, c’est le Moyen-Âge en marche. Nous pourrions y voir simplement une croyance, puisque chez Buber nous invoquions aussi une croyance, et pour autant je n’ai pas la même critique. Mais c’est très différent chez Buber : il pose en premier lieu la réciprocité. Certes il la considère dans la lumière de l’absolu, mais c’est son droit, puisque la conséquence reste la reconnaissance réciproque des réciprocités. Mais si la réponse à l’absolu doit m’obliger soit à me soumettre, soit à obéir, alors je ne suis pas d’accord, parce qu’il ne faut pas oublier une chose : pendant que moi je me soumets, c’est l’autre qui me domine, évidemment.
Cette ontologie de la séparation, d’où vient elle ? Pourquoi cette affirmation ? Ce qui est remarquable dans la doctrine de Lévinas c’est qu’à chacune de ses affirmations, nous sommes en droit de nous demander d’où provient-elle et sur quelle autre affirmation non justifiée s’appuie-t-elle ?
J’insiste ici parce que c’est une sorte d’occasion pédagogique pour moi d’en appeler à la rigueur et à l’exigence rationnelle en philosophie. Il y aura aussi un troisième terme avec l’exigence existentielle, c’est autre chose que nous verrons plus tard. La raison n’est en effet pas pour moi sa propre fin, elle est l’instrument de quelque chose d’autre. Quelle est donc la théorie soutenue derrière cette ontologie de la séparation ? Nous le savons, il y a un a priori qui est le judaïsme, je n’y reviens pas. Je veux plutôt insister sur la médiation logique sur laquelle nous sommes passés trop vite. J’essaie ici au passage de vous donner des instruments de lecture, ou de méthode : la médiation logique va consister à prendre conscience de la signification et de la portée d’une série d’autres remarques que Lévinas fait, non pas à propos de l’ontologie de la séparation, mais à propos de Spinoza.
Nous avons déjà dit, mais trop rapidement, que Lévinas était tout à fait hostile à Spinoza.
Spinoza est rarement nommé, jamais positivement. Il est toujours critiqué, et pour Lévinas, il représente la « philosophie occidentale ». Ce qu’il reproche à Spinoza, c’est le rationalisme, son hostilité à la religion juive, à la religion chrétienne, et à la religion judaïque. Spinoza est un philosophe athée qui fonde la laïcité dans le monde moderne, il est hostile à toutes les religions. Cela que Lévinas ne peut l’admettre. Quand on s’aperçoit de la place des références à Spinoza chez Lévinas, on voit que ce qu’il reproche à Spinoza, c’est sa critique de la religion, c’est à dire sa critique des conceptions religieuses de l’être. On découvre alors que ce qui importe à Lévinas, c’est de défendre une certaine conception religieuse de l’être. Il est tout à fait éloquent de constater que chez Buber, qui est religieux aussi et qui se réfère aussi au Judaïsme, il n’y a jamais une critique de Spinoza, bien qu’il soit pourtant philosophiquement aux antipodes. Donc, cela a attiré mon attention et m’a permis de voir qu’en réalité, il y avait chez Lévinas une sorte de volonté de fonder religieusement une philosophie.
Puisque Lévinas critique Spinoza, nous allons saisir l’occasion pour creuser le spinozisme. Je vais donner quelques indications sur Spinoza, sur les relations à autrui chez Spinoza. Nous reviendrons par la suite sur la métaphysique de Lévinas, mais pour l’heure nous allons parler de Spinoza, dans l’ordre de ses œuvres.
D’abord, nous allons parler du Traité théologico-politique. Il s’agit de la première entreprise dans la philosophie moderne, contemporaine, de critique rationnelle des Écritures. Cette critique concerne les Écritures, quelles qu’elles soient, la Bible, la Torah ou les évangiles, n’importe quelle écriture. Spinoza mets en oeuvre une démarche scientifique de critique du caractère sacré des Écritures. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de cette critique faute de temps, mais je vous invite à y réfléchir et à en retenir l’essentiel.
Spinoza regrette toutes les persécutions religieuses et déplore qu’on ait détruit tous les instruments de sa civilisation. il n’y a plus de grammaire moderne, il n’y a plus de dictionnaire, plus de document historique, il n’y a plus aucun outils de connaissance susceptible à terme de nous donner des points d’appui pour éclairer la Bible. Spinoza en conclu il nous faut éclairer la Bible par la Bible elle-même. Mais comment ? En adoptant un point de vue qu’on pourrait qualifier de pré-scientifique, ou plus précisément de réflexif. Il va s’appuyer sur la langue de la Bible, c’est à dire l’hébreu, pour montrer qu’on fait dire à la Bible ce qu’elle ne dit pas. On croit dans toute la religion du XVIᵉ siècle que Dieu inspire la Bible. Spinoza va montrer que la Bible est une œuvre humaine, qui repose sur une certaine utilisation d’une certaine langue dont les auteurs ne sont évidemment pas ni l’absolu, ni Dieu. Quelle est selon Spinoza la signification de l’Ancien Testament ? Résumons schématiquement : il ne s’agit pas du tout la Parole de Dieu, mais d’un effort de législation pour constituer une nation. L’Ancien Testament est donc simplement un effort de législation dont l’acteur principal est Moïse. Moïse est un législateur qui, comme, tous les autres fondateurs qui ont construit des nations, a construit, fondé, rassemblé, structuré les peuples hébreux. Quel est donc in fine l’intérêt de l’Ancien Testament ? Il nous donne en réalité des informations politiques.
La première information politique concerne la ruine des Etats. Au lieu comme Machiavel d’étudier la ruine des Etats romains, Spinoza étudie la ruine des États Juifs. En se référant au royaume de Salomon (4000 ans avant JC) Spinoza montre qu’à un certain moment, les Etats se figent, se scindent. Une guerre les ruine puis les livre à l’envahisseur. Les envahisseurs, ce fut d’abord les Babyloniens qui rasaient tout sur leur passage et ont détruit Jérusalem en 588 avant Jésus-Christ, c’est la destruction du premier Temple. La ruine des États vient d’où ? D’une faiblesse offerte devant l’envahisseur, mais d’une faiblesse issue de l’intérieur et provenant de la répartition entre pouvoir civil et pouvoir religieux, c’est-à-dire de la division des pouvoirs entre les juges et les prêtres. Les juges ou les rois, c’est-à-dire les administrateurs ou encore les politiques, ne pouvaient pas décider n’importe quoi. Il fallait qu’ils fassent référence aux prêtres, qu’ils leur demandent si Dieu est d’accord, si leur décision est conforme à la religion. C’est de cette opposition que naît la ruine de l’Etat.
Le deuxième enseignement, bien plus important et tout aussi universel du Traité théologico-politique relève de la politique générale. La lecture de la Bible permet à Spinoza, qui réfléchit sur la signification de l’alliance, lui permet de formuler une nouvelle doctrine politique non religieuse, valable pour toute société humaine.
C’est la doctrine du pacte social.
Je vous invite vivement à lire le chapitre 16 du Traité Théologico-Politique. Ce qu’il dit dans ce chapitre est d’une importance absolument considérable, c’est le chapitre qui va bouleverser toute l’Europe. C’est par la médiation de Spinoza que peu à peu les théories du contrat vont se former en Europe. A l’inverse de Hobbes qui est un monarchique qui veut que les individus abandonnent leur droit au profit d’un Monarque, d’un chef, un dictateur, pour Spinoza l’abandon des droits doit se faire au bénéfice de la collectivité. Spinoza est le fondateur du pacte social, mais dans une perspective démocratique. Quel est le message de la doctrine dans ce chapitre 16 ? Cette doctrine, reprise en détail dans le traité politique, est évoquée brièvement dans l’Ethique, par exemple : L’homme qui est conduit par la Raison est plus libre dans la Cité où il vit selon le décret commun, que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même (Éth. IV 73). J’évoque cela pour vous montrer que l’Ethique entérine la doctrine du pacte. Quelle est donc cette doctrine entérinée par l’Ethique développée dans le Traité politique, mais exprimée pour la première fois dans le Traité théologico-politique ? Elle est d’autant plus intéressante que nous avons affaire à un philosophe qui ne se réfère plus à une morale traditionnelle, ni à un Dieu transcendant. Il ne se réfère pas à une morale de la crainte ou de l’obéissance. Il ne se réfère pas à une conscience religieuse et il ne se réfère pas à une conscience morale, ni à une « conscience consciente » comme dit Rousseau dans l’Emile se référant ainsi à l’instinct divin, la marche de Dieu en nous, etc. Spinoza critique tout cela en avance. D’où l’intérêt de lire Spinoza, qui a l’audace de proposer des fondations pour une morale qui ne soient plus ni traditionnelles, ni religieuses. Vous voyez que chez Spinoza nous sommes bien plus avancés que chez Lévinas.
Voici la doctrine à présent : l’essence de l’homme c’est le Désir, c’est à dire le conatus. Désir se dit cupiditas, et ce terme est égal à conatus qui signifie : effort pour vivre, effort et se maintenir dans l’être, effort pour persévérer dans l’existence. Cet effort pour persévérer dans l’existence est une manifestation de la puissance d’exister, et rien d’autre. Cette manifestation de la puissance d’exister n’est pas de la volonté de dominer, ni avec une volonté de puissance, il s’agit du déploiement de la puissance de vivre. C’est ce déploiement de la puissance de vivre est l’essence de l’homme, ce n’est ni un bien ni un mal. Dans la Nature, il n’y a pas de vice (cf. préface d’Ethique III). Tout homme est volonté d’exister, tout homme est Désir. Tout homme dans la nature est puissance d’exister.
Si nous réfléchissons sur le droit qu’allons nous dire ? Spinoza l’affirme clairement, et c’est vrai que tous les individus, sans aucune exception : la puissance de la nature ou la puissance naturelle de chacun définit son droit de nature.
Si on la prend en l’air comme ça, séparée de tout le reste, l’expression « droit naturel » convient à Rousseau. Le droit naturel chez Rousseau, c’est un certain nombre de droits qui, en réalité, sont des droits peu à peu élaborés par la société. Le droit de propriété, le droit à un salaire, le droit au travail, le droit de vote. On les appelle des droits naturels, ou droits de l’homme, ils proviennent en réalité de la théorie du XVIIIᵉ siècle, qui est moralisatrice. Pour Spinoza c’est tout à fait différent, les droits sont marqués par la puissance. Pour autant, s’agit-il d’une doctrine de la domination du plus fort ? Pas du tout, parce que Spinoza le précise : c’est à peine un droit, ce droit de nature.
Poursuivons.
Certes, l’homme dans la nature a le droit de faire tout ce qu’il peut. Autrement dit tout ce qu’il peut, il a le droit de faire, sa puissance lui confère le droit. Mais le mot « droit » ne va plus convenir, à cause de l’étape suivante du raisonnement. Dans l’état de nature, l’homme a donc le droit de sa force. Mais n’oublions pas une chose : c’est vrai pour tous. Il y a là un universel. Tous les hommes sont des êtres de désir et de puissance d’exister et tous veulent accroître leur puissance d’exister pour accroître leur joie. Il va y avoir des conséquences à cela, et les conséquences, c’est la guerre. Si chacun veut seulement déployer sa force, il ne doit pas oublier, pourvu qu’il soit un tout petit peu intelligent, qu’il en va de même pour l’autre. Admettons que le droit soit définissable par la force. Je vous vole votre montre et vous ne pouvez pas vous défendre, alors la montre est à moi. Mais il peut très bien se faire que 30 secondes après, vous me voliez mon portefeuille, qu’est ce que je peux faire ? Je ne peux pas me défendre, pas plus que vous tout à l’heure. Quelles sera la suite ? Ou bien je vous me rends ma montre et vous me rendez mon portefeuille, ou bien on se bat. Si nous ne sommes que deux, il y une sur deux restera sur le carreau, mais après ça va recommencer, c’est à dire que ça va se multiplier par des milliards d’individus. Nous pouvons alors reprendre la formule de Hobbes : c’est la guerre de tous contre tous.
Résumons: la première étape c’est droit de nature, mais alors c’est aussi la guerre, car le droit de nature n’est réservé aux les plus forts, il est à l’oeuvre pour tout le monde. Ici n’oublions pas que nous avons avec Spinoza affaire à la réalité humaine, nous sommes en train de décrire des hommes, pas des animaux. Or, les hommes ont le pouvoir de raisonner, et voilà l’origine du pacte social. Placés grâce à la raison devant les inconvénients, les impossibilités et les absurdités d’une telle situation, les hommes qui étaient dispersés décident de s’allier et de passer un pacte social. En quoi consiste il ? Le pacte est la décision rationnelle commune et libre au terme de laquelle chacun abandonne une partie de ses pouvoirs. On peut toujours voler les montres du voisin, mais il peut toujours voler les portefeuilles du voisin. Chacun abandonne une partie de ses pouvoirs, pourvu que l’autre reconnaisse rationnellement et socialement le respect absolu d’un certain nombre d’autres droits. Par le dialogue direct, ou comme dirait Buber dans une réciprocité directe, on précise lesquels on abandonne, lesquels on conserve etc. Et que se passe-t-il ? On crée un droit. La reconnaissance mutuelles de l’autre prend alors la forme dans un droit écrit, on crée une société. La société est le premier résultat rationnel de la fin de la guerre et du passage à la raison, et cette société est définie justement par le droit. C’est cette société qui définit ce qu’est une conscience morale universelle et non plus religieuse et superstitieuse. C’est cette société qui va définir le juste et l’injuste, la propriété, la non-propriété, etc. Par exemple, dans le Traité politique, il y a l’évocation d’une propriété collective de la terre, pourvu qu’elle soit décidée par tous, ensemble. Le droit est un cadre commun, un pacte social. C’est une doctrine d’une importance considérable, qui va avoir des répercussions sur tout les XVIIIᵉ siècle, qui peut nous éclairer sur l’origine de toute société.
Les commentateurs qui étudient Rousseau ont raison de dire la chose suivante : ce pacte peut être n’a-t-il jamais eu lieu explicitement, mais c’est bien ce pacte ainsi explicité qui éclaire la naissance de la société. Même s’il n’y a pas de pacte explicite, en fait, il y a un pacte implicite. Prenons l’origine préhistorique des sociétés et des groupes sociaux, les humains qui commencent par confronter leurs forces, un certain moment, renoncent à la guerre. Ils s’aperçoivent que ça serait mieux s’il y avait des conventions. Puis, peu à peu ils les font, car cela prend du temps, puis il y a des conventions qui peu à peu devient des coutumes puis peu à peu deviennent du droit strict. Autrement dit, ce qui fait l’humanité c’est le passage à la raison, qui se traduit dans la société par l’État de droit. Un État de droit, c’est un État qui s’est appuyé sur un certain nombre de droits constitutionnellement définis. Le droit commun a d’ailleurs pour contenu et pour tâche de rendre possible le respect des droits précis de chacun, tels qu’ils sont définis par les textes les plus récents sur lesquels il y a eu accord commun, comme par exemple une constitution, ou encore un traité de paix international.
Ce pacte social va en même temps définir les instances qui vont gouverner. Il y a le mot colegialiter dans le chapitre 16 du Traité théologico-politique de Spinoza, les pouvoirs vont être traités collégialement, c’est la base de la démocratie. Il ne fait pas seulement dans le Traité théologico-politique la critique de la monarchie, car Spinoza l’explique très bien : les monarchies sont des mystifications, parce qu’il n’y a pas réellement de monarchie. C’est toujours le groupe qui gouverne et qui se fait représenter par un individu qu’on appelle le Roi, le Chef, le Duché ou tout ce que vous voulez. Mais un homme seul ne peut pas gouverner des masses dit Spinoza, donc il s’agit en réalité une monarchie aristocratique. Ensuite il décrit des aristocraties qui seraient préférable à celle qu’on connaît au XVIᵉ siècle, puis peu à peu à la fin du Traité politique, il commence à décrire la démocratie.
C’est ainsi que sont garantis la concorde et la sécurité, qui sont les buts d’une société. Spinoza parle de paix, il s’agit de la concorde, de l’harmonie et de la sécurité. Les individus doivent être, et savoir qu’ils sont sous la protection des lois, et non pas l’objet d’agressions violentes venues du caprice d’un individu. Le but de la société n’est pas vraiment de définir le bonheur. Nous pouvons regarder mon introduction au Traité politique, que j’ai intitulée Ethique philosophique et théorie de l’État. Les textes de Spinoza permettent de dire ceci : sur la base de la doctrine du pacte que je viens de décrire, l’État est destinée à garantir la concorde et l’harmonie. La paix, la concorde, la sécurité, voilà les seuls buts de l’État. Si on va un tout petit peu plus loin, je me réfère à une phrase du Traité théologico-politique, l’Etat doit aussi garantir la possibilité de la vraie vie de l’esprit, c’est à dire l’exercice de la philosophie, l’exercice de la connaissance, l’exercice de la sagesse. La vraie vie de l’esprit, dont le meilleur représentant est selon Spinoza le roi Salomon, qui a des textes de sagesse et de réflexion, le Christ étant, pour Spinoza, le meilleur représentant de l’esprit de charité. Le Christ, c’est la charité, Salomon, c’est la vraie vie de l’Esprit, et tous les deux pour Spinosa des hommes qui sont des penseurs admirables.
Je reviens au pacte de l’État : il s’agit de rendre possible, mais pas de définir la vraie vie de l’esprit. En Spinoza a critiqué à l’avance tous les dogmes. Par exemple si nous pensons au petit livre rouge de Mao c’est incroyable, 600 million de Chinois devaient avoir une seul doctrine : celle du petit livre rouge de Mao. Spinoza est à l‘opposé de tout ça. Si l’état doit garantir, sur la base d’un pacte social et d’un gouvernement collégial la vraie vie de l’esprit, il s’agit de la libre vie de l’esprit. A ce moment le philosophe intervient et dit : pour quoi faire ? Pour travailler personnellement et individuellement à l’accès à la béatitude. C’est à dire que la politique démocratique, l’idéal de la politique, c’est d’être au service de la liberté individuelle de l’esprit, chacun alors ayant la possibilité matérielle, puisqu’il est dans la sécurité, l’harmonie, la liberté et l’esprit de tolérance de rechercher le bien véritable. A la fin du Traité théologico-politique, Spinoza nous dit que dans une libre république nul ne sera condamné pour ses opinions. Alors, dans une société démocratique, l’individu peut alors, mais alors seulement, commencer à se consacrer au travail qui le concerne seul, et qui ne concerne plus le pouvoir et qui est la recherche de la béatitude, et à ce moment, on a l’Ethique. Par conséquent chez Spinoza, la description de la forme rationnelle et démocratique des relations entre les citoyens est première forme de la relation à autrui. Il y aura harmonie lorsqu’il y aura insertion dans une société de droit, elle-même d’inspiration rationnelle.
Allons plus loin, qu’en est il dans l’Ethique à présent, des relations avec autrui ?
Nous allons distinguer deux moments. Précaution préalable : le mot passion est très rare de Spinoza, il y a les mots affect passif, que nous pouvons traduire dans cet exposé par commodité, par « passion ». Le premier moment, c’est le moment de la passion. Le premier stade c’est les relations passionnelles entre les gens. Ces relations sont fondées sur l’imagination et sur le Désir. Je reprends les deux concepts, mais dans l’autre sens. D’abord sur le Désir, c’est à dire le conatus. Dans l’Ethique comme dans le Traité théologico-politique, l’individu humain a pour essence le Désir. Le Désir est l’essence de l’homme (cf. définition générale des affects, à la fin de Eth. IIII). Le Désir, c’est à dire le mouvement ou l’accroissement du pouvoir d’exister est l’essence de l’homme. Ce conatus, quand il s’accroît, est perçu lui-même avec joie, et c’est cela l’essence du Désir. La joie est le sentiment de l’accroissement du pouvoir d’exister. Notre puissance d’être, quand elle s’exprime, se manifeste et s’accroît, nous donne de la joie. C’est le premier point et c’est à partir de là que nous aurons plus tard à construire une éthique. Pour le moment je vais me centrer sur le problème d’autrui.
Le deuxième fondement ordinaire de la relation à autrui, c’est hélas : l’imagination. Que va te faire l’imagination ? Elle va, utiliser à sa façon le conatus. Elle va donner des vies imaginaires au Désir. Volonté de puissance, égoïsme, gloire, ambition, au sens politique et vulgaire du terme. C’est dans la troisième partie de l’Ethique, à propos des affects et de cette science des affects, que Spinoza que très souvent, les relations à autrui commandées par le désir et l’imagination sont des relations d’imitation et de concurrence. De là viennent les conflits, la ou les tristesses, c’est-à-dire la voie de la souffrance. Pour reprendre les choses au début, ordinairement, au niveau de la connaissance du premier genre, on ne réfléchit pas, on connaît en répétant, par ouï-dire. On vit selon la l’empiricité immédiate, on vit n’importe comment. Alors, à ce moment, on est poussé simplement par le conatus et l’imagination. Et comme le conatus, spontanément, éprouve la plus grande joie quand il y est le plus fort, alors l’imagination lui donne lui donne une patine. Je schématise un petit peu l’explication par Spinoza. L’imagination, quand nous vivons selon la connaissance du premier genre, nous incite à d’abord nous penser plus forts que nous sommes, à nous donner des vues qui entraîneront l’admiration du monde. C’est à dire qu’émulation , concurrence et domination vont être le fruit de l’imagination au service du Désir. Remarquez combien les analyses de Spinoza sont modernes. À ce premier stade, notre conscience est dans la servitude, parce nous dépendons de l’opinion des autres. Nous dépendons de buts imaginaires, qui n’ont pas décidés vraiment, parce que nous agissons en vertu de principes qui ne découlent pas de notre véritable essence. Nous n’agissons pas vraiment par nous-mêmes, mais par impulsion extérieure, par une imagination extérieure, par imitation, par concurrence, par inversion des affects. L’ennemi de qui j’aime, je le haïrai, ou l’ami de qui j’aime, je l’aimerai. Mais l’ennemi de qui je hais, je l’aimerai. Il y a des sortes de mécanismes affectifs (ce ne sont pas véritablement des mécanismes, je dis des « sortes » pour vous mettre sur la voie d’un lecture détaillée) nous explique Spinoza, pour quoi faire ? Pas du tout comme certains psychanalystes étudiant Spinoza le croient, pour abaisser l’humanité et nous dire, regardez, vous êtes le jouet de votre imagination passive. Pas du tout. Spinoza dit ceci : il n’y a aucun vice dans la nature, mais dans la spontanéité cela se passe souvent comme cela.
Que pouvons nous faire ? Nous pouvons beaucoup : il nous faut tout changer. Première conclusion, ce qui divise les hommes, c’est leurs passions. Ce qui les unit, c’est la raison. Ce que préconise Spinoza, c’est donc ceci : il faut passer du stade imaginatif de la connaissance et de la relation passionnelle à autrui, à un stade rationnel par la connaissance. Alors, à ce moment, on sera en liaison avec autrui, d’une façon affirmative, positive et pas négative. La vertu principale sera la grandeur d’âme ou générosité. La générosité n’étant pas du tout la soumission passive à l’autre, mais le libre et rationnel désir de l’affirmer et de l’aimer. Ce que le philosophe toujours recherche, c’est l’amitié utile. « Rien n’est plus utile à un homme qu’un autre homme vivant sous la conduite de la raison » nous dit Spinoza, car à ce moment, les hommes sont dans une même perspective. Pour reprendre le vocabulaire de Lévinas, mais en le critiquant avec Spinoza, je dirais que la passion fait de l’autre, par rapport à moi un étranger que je vais combattre ou auquel je vais me soumettre. La raison en fait de l’autre un prochain, le même que moi, quitte ensuite à ce que chacun, dans la libre vie de l’esprit, définisse intérieurement sa voie philosophique comme il l’entend. Mais pour les relations à autrui, il y aura amitié et raison, et non pas concurrence et passion.
Voilà, nous continuerons la prochaine fois, à partir de là.