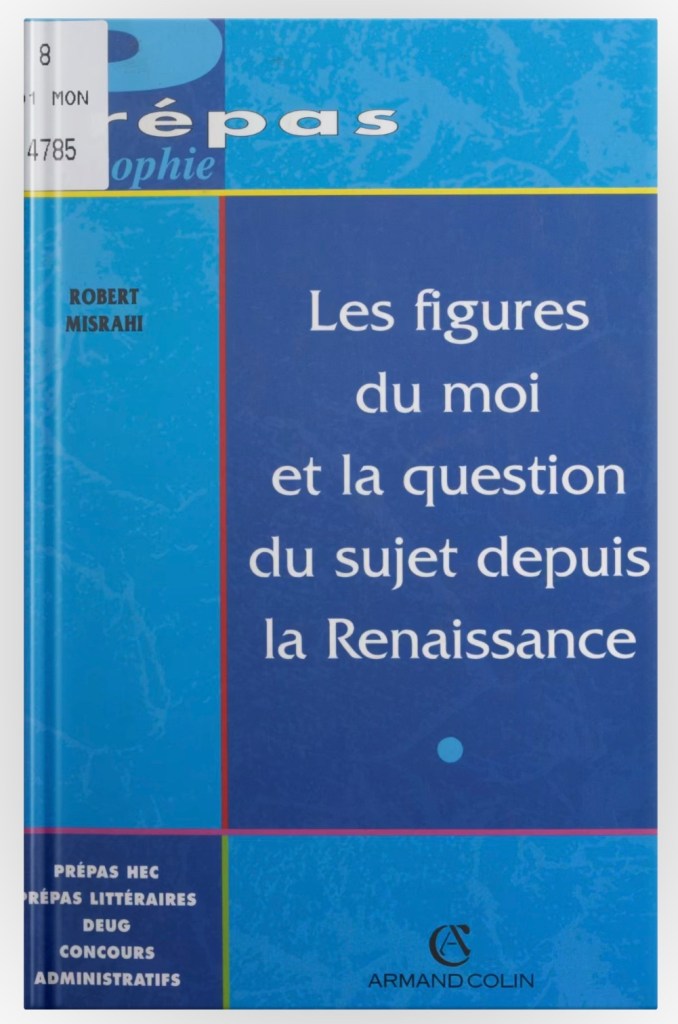1 La révolution cartésienne et le sujet comme fondement
Le Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences parut en 1637, à Leyde (Pays-Bas), en langue française. Son influence fut telle qu’on peut faire partir de cette date la nouvelle ère philosophique qui allait être marquée par l’instauration d’une réflexion explicite sur le sujet. L’œuvre de Descartes, notamment par ce Discours de la méthode et par les Méditations métaphysiques (publiées en latin en 1641 et traduites en français en 1647) constitue une véritable révolution dans la pensée philosophique, et cette révolution est implicitement reconnue par Husserl, en 1929, à Paris, comme l’acte de naissance sinon de la phénoménologie elle-même, du moins de son inspiration (cf. Husserl, Méditations cartésiennes, Introduction à la phenomenologie).
En effet, le Discours de la méthode ne veut être qu’une introduction méthodologique à des traités scientifiques : la Dioptrique, les Meteores, la Géometrie. Le Discours est donc une manière d’épistémologie fondamentale et, plus précisément, une théorie de la connaissance : Descartes, en consommant définitivement et clairement la rupture avec le Moyen Age et l’aristotélisme scolastique, recherche les conditions d’une connaissance vraie qui soit certaine par elle-même et non pas par un recours à l’autorité ou à la coutume. Cette connaissance sera rationnelle et objective, ses instruments seront l’observation empirique et le raisonnement mathématique qui inspire sa réflexion méthodologique. L’attention prêtée, dans l’élaboration de la connaissance, à l’enchaînement rigoureux des concepts, des définitions et des conséquences, ainsi que le sentiment qu’il existe un ordre de vérités certaines et démontrables, cette attention et ce sentiment ont pour origine la réflexion sur les mathématiques et l’attachement à ce qui constitue leur principale signification.
De ce seul point de vue épistémologique, on pourrait dire que la pensée cartésienne est radicalement novatrice : c’est le mécanisme cartésien (qui est la théorie causale et déterministe du monde physique, c’est-à-dire de la nature), ainsi que la méthode mathématique comme instrument de ce mécanisme, qui portent à sa pleine conscience le mouvement rationaliste qui s’exprimait déjà chez Léonard de Vinci, Kepler ou Galilée. La théorie cartésienne de la connaissance affirme enfin clairement l’autonomie de la raison et les exigences de la méthode scientifique.
Pourtant, ce n’est pas dans cette prise de conscience de la connaissance rationnelle par elle-même que réside l’essentiel de la révolution cartésienne : celle-ci est bien plutôt constituée par l’élucidation des conditions et des fondements d’une telle connaissance. Et cette élucidation est la mise en évidence du sujet lui-même.
Certes, dans le Discours, aussi bien que dans les Méditations, Descartes s’efforce en première analyse, de définir les conditions d’une connaissance qui puisse échapper à la mise en question et à l’incertitude. Mais, sur ce chemin, il découvre non seulement les conditions logiques mais encore la condition ontologique de toute vérité et de toute certitude : le sujet lui-même.
Recherchant une vérité indubitable, il rencontre l’évidence comme critère d’une telle vérité. En effet, l’évidence (comme intuition intellectuelle immédiate) est le critère qui résulte du travail critique de destruction de toutes les connaissances, puisqu’elle accompagne la seule connaissance qui soit indestructible, à savoir : la conscience de sa propre existence.
Mais, à partir de là, s’opère un glissement ou un déplacement de l’intérêt philosophique.
Aussi bien Descartes lui-même que son lecteur orientent désormais leur attention non plus sur un résultat épistémologique (l’évidence intuitive et personnelle est le seul critère valable de la vérité d’une connaissance) mais sur le fondement de ce résultat : la conscience de soi, en première personne.
C’est cette conscience de soi qui va constituer la véritable révolution cartésienne, et marquer de son sceau le bouleversement que la philosophie connaîtra dans la nouvelle ère qui s’ouvre.
Déjà, chez Descartes, cette révolution est d’une richesse inépuisable.
Ce dont il est d’abord question, au-delà de la recherche épistémologique, c’est de l’âme. Dans les Méditations, Descartes s’efforcera de démontrer « l’immortalité de l’âme » et affirmera (nous y reviendrons) que l’âme est plus facile à connaître que le corps. Or, Descartes ne commence pas par poser l’âme en se proposant de l’étudier (selon la démarche traditionnelle). Il commence par une interrogation radicale et rencontre une évidence radicale : ce qui est remarquable est que cette évidence n’est pas celle de l’âme ou d’une chose quelconque, mais celle d’une conscience de soi : « je suis, j’existe ».
Simultanément, les démarches traditionnelles sont, ici, rendues caduques, et se met en place une expérience qui semble encore n’avoir pas de nom et qui est à la fois une conscience et une existence, ou plutôt, dans la perspective cartésienne, une conscience et un être. Seule l’expression Cogito permettra d’exprimer cette expérience surdéterminée. Elle est à la fois conscience présente et active (je doute, je pense, je suis), conscience en première personne (c’est moi qui pense et qui existe), et existence véritable (malgré mes doutes et à travers eux, je vois bien que je suis et que j’existe).
Ainsi, trois dimensions sont simultanément données en un seul acte de pensée, celui qui s’exprime par Cogito ergo sum : la conscience, la conscience de soi en première personne, la conscience personnelle comme existence.
Sont donc indissociables : la conscience, l’existence, la première personne. C’est précisément dans cette unité indissociable que consiste ce qu’on est désormais convenu d’appeler le sujet, et c’est cette unité indissociable qui constitue la véritable révolution, le bouleversement radical instauré par Descartes à propos de la connaissance de l’âme. Celle-ci n’est plus, comme dans l’Antiquité, une réalité spirituelle impersonnelle dont on pouvait parler et à propos de laquelle on pouvait échafauder des mythes ou qu’on pouvait analyser comme une chose. Elle n’est pas non plus, comme dans la Renaissance qui s’achève, une réalité certes individuelle et admirable mais constituée encore comme une chose dont il importerait surtout de savoir si elle est d’origine divine ou naturelle, et dont la propriété principale, la conscience, serait encore mal dégagée des autres propriétés, telles que l’immortalité ou la faculté rationnelle. Chez Descartes, au contraire, la conscience devient enfin la détermination essentielle de l’âme, et cette conscience est à la fois une existence et une conscience personnelle : après avoir imaginé d’abord que toutes ses anciennes idées ou opinions étaient fausses; et après avoir imaginé ensuite que tout était vrai mais qu’il avait cessé de penser, Descartes est en effet conduit à la conclusion décisive : « je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, et qui. pour être, n’a besoin d’aucun lien, ni ne dépend d’aucune choses matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, et qu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait point d’être tout ce qu’elle est » (Discours de la méthode).
Ainsi, c’est bien de l’âme qu’il s’agit : mais elle est enfin identifiée à la conscience et cette conscience, ou activité de penser, est un moi. La distinction n’est pas encore faite entre le sujet et le moi (nous verrons plus loin que c’est cette distinction qui fait problème, et qu’en affirmant l’unité de la pensée, c’est Descartes qui anticipe une vérité fondamentale); mais le progrès décisif est accompli : à partir de l’expérience ultime, succédant à tous les doutes possibles, expérience évidente du « je pense donc je suis », le philosophe a cerné la vérité centrale et décisive. L’âme est certes une substance, mais l’intégralité de son être, c’est-à-dire de son essence, consiste en l’acte de penser. Quels que soient le « malin génie » ou le « trompeur très puissant » qu’on se plairait à imaginer, il reste que la proposition « je suis, j’existe », proposition à la fois ontologique (quant à l’être) et personnelle (quant au sujet qui la prononce) « est nécessairement vraie toute les fois que je la prononce (« Méditation seconde »).
Cette « proposition vraie », de même que la proposition « je pense donc je suis », ne sont pas un raisonnement, mais l’expression unitaire d’une expérience qui est une conscience de soi.
La dernière proposition est l’élucidation ou le développement d’une implication entre l’acte de penser et le fait d’exister, l’exercice de la pensée ne pouvant être accompli que par un être existant.
***
Cette vérité est décisive à plus d’un titre, et la révolution cartésienne comporte plusieurs significations qu’il importe de distinguer si l’on veut en évaluer pleinement la portée.
Nous sommes d’abord en présence d’un principe méthodologique : de cette expérience du Cogito, Descartes tire la règle de l’évidence intellectuelle comme critère ultime de la vérité. Les quatre « préceptes » du Discours découlent de ce principe : c’est à partir de ce critère (premier précepte) qu’il convient d’analyser, de dénombrer et de synthétiser soigneusement les difficultés d’un projet de connaissance, et surtout c’est grâce à ce critère qu’il est possible de conduire une connaissance discursive qui suive un ordre logique et rigoureux, allant du simple au complexe, en soumettant constamment à l’exigence d’évidence claire et distincte les enchaînements et les déductions.
Du point de vue méthodologique, la pensée cartésienne est donc à la fois subversive et prudente, puisqu’elle donne le moyen et la raison du rejet de toutes les idéologies (« opinion » et « coutumes ») traditionnelles, tout en se refusant à renverser l’ordre politique ou les croyances coutumières et pratiques.
Mais cette prudence n’est que l’expression d’une pensée qui se veut radicale et qui veut, en commençant par le commencement, commencer en effet d’une façon radicale. Toute la signification de cette méthodologie cartésienne réside en effet dans cette nouveauté : la pensée ne peut s’exercer valablement que si elle trouve un fondement pour appuyer son développement, et si elle commence effectivement à se déployer à partir de ce fondement.
La découverte du fondement est d’abord la découverte, effectuée clairement en une langue française qui est une langue moderne, de cette exigence pour la philosophie et la science de se donner des fondements. Le génie cartésien a consisté à prendre conscience de la nécessaire recherche d’un fondement pour une connaissance future, avant même qu’il n’ait défini et déterminé ce fondement. Et ce pressentiment, cette exigence première, cette recherche préliminaire et fondatrice, revêt chez Descartes une signification que nous pourrions dire existentielle.
En effet, la recherche cartésienne exprimée dans une langue littéraire et philosophique aussi pure que vive, aussi précise qu’elle est intense, se déploie dans un climat de tension ramassée qui exprime bien un enjeu existentiel. Tout se passe comme si la recherche de la vérité conditionnait l’existence même du philosophe, la consistance, la validité et la signification même de sa vie.
Et Descartes s’exprime en effet à la première personne : « La méditation que je fis hier m’a rempli l’esprit de tant de doutes, qu’il n’est plus désormais en ma puissance de les oublier […] et comme si tout à coup j’étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. » Sans la découverte, ou la rencontre d’un « fond » qui puisse valoir comme point d’appui ultime et solide, il semble bien que l’individu risque de se noyer et de se perdre. Et la découverte d’un tel fondement est d’autant plus urgente (au début de la « Méditation seconde ») que les doutes qui ont précédé ont fait perdre « le repos et la tranquillité » qu’on voit dans les songes des esclaves qui rêvent d’une « liberté imaginaire » (comme le dit la fin de la « Première Méditation »). Le dessein philosophique est « penible et laborieux » : la recherche du fondement n’en est que plus impérieuse, puisque seule la connaissance d’un tel fondement, valant à la fois comme critère indubitable et comme commencement fécond, permettrait d’accéder au repos de la certitude.
Le fondement de la vérité n’est pas seulement l’origine de la connaissance vraie, il est aussi le remède contre l’inquiétude.
D’autres images, sous la plume de Descartes, renforcent le sentiment sinon toujours d’inquiétude du moins de gravité, accompagnant la réflexion sur le fondement. Les images les plus fréquentes concernent l’architecture. A propos des sciences de son temps, Descartes juge « qu’on ne pouvait avoir rien bâti qui fût solide sur des fondements si peu fermes » (Discours de la méthode, Première partie). À propos des opinions en général : « Il est vrai que nous ne voyons pas qu’on jette par terre toutes les maisons d’une ville pour le seul dessein de les refaire d’autre façon… mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et que même, quelques fois ils y sont contraints quand elles sont en danger de tomber d’elles-mêmes et que les fondements n’en sont pas bien fermes. »
Ces images sont éloquentes : ce n’est pas par vaines futilité qu’il y a lieu de détruire, mais en raison du délabrement et de l’effondrement des édifices. Il y a lieu ensuite de reconstruire. Et il faut reconstruire un savoir comme on construit un nouvel édifice : sur des bases fermes et assurées qui puissent en effet supporter valablement toute la nouvelle construction, et la mettre à l’abri de tout risque d’effondrement.
Comme l’image de l’eau sans fond, celle de la maison effondrée exprime bien l’inquiétude cartésienne en même temps que la gravité et l’urgence de son projet de reconstruction : ce projet a valeur existentielle. Pourtant, Descartes est resté « neuf années » sans prendre « aucun parti touchant les difficultés qui ont coutume d’être disputées entre les philosophes » et sans qu’il eût « commencé à chercher les fondements d’aucune philosophie plus certaine » (Discours de la méthode, Troisième partie). Mais c’est bien d’une telle recherche qu’il s’agit : la recherche des fondements est le commencement de la vraie philosophie. Et le philosophe, à la fin, ne peut pas s’abstenir de se jeter dans l’eau profonde et inquiétante de cette recherche, comme il ne peut pas s’abstenir « d’en parler », « afin qu’on puisse juger si les fondements [qu’il a] pris sont assez fermes » (Ouatrième partie).
A l’horizon de cette recherche intense d’un fondement assuré se profile donc un enjeu existentiel: au-delà de la validité de la vérité, ce qui est en question pour Descartes est le contenu métaphysique de cette vérité; et ce contenu sera constitué par l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme, comme le titre complet des Méditations le laisse entendre (Méditations touchant la Premiere philosophie, dans lesquelles l’existence de Dieu et la distinction réelle entre l’âme et le corps de l’homme sont démontrées).
Ainsi, le fondement de vérité que constitue le Cogito est à la fois, dès le principe, méthodologique et métaphysique, en d’autres termes, épistémologique et existentiel.
Avant de réfléchir sur ce contenu métaphysique (Dieu et l’immortalité) nous devons approfondir la signification « épistémologique » du Cogito.
Cette signification est multiple et comporte plusieurs aspects. Le Cogito n’est pas seulement (comme nous l’avons vu) la découverte d’un critère de validité, l’évidence. Il n’est pas non plus réductible à la seule recherche inquiète et « existentielle » d’une certitude pour la connaissance, pour la vie et pour la « sagesse ». Il est en outre le commencement à la fois doctrinal et méthodologique d’une doctrine du sujet, cette doctrine et ce commencement étant parfaitement neufs.
« Je pense, j’existe » est une proposition certes, mais elle exprime un acte de la pensée. Cet acte livre immédiatement deux verites : d’une part la nature et la valeur de l’évidence (elle est critère ultime, clair, distinct et irrécusable) et d’autre part le contenu même de cette évidence (le sentiment d’exister est donné dans l’acte même de penser, de même que, inversement, la pensée en acte implique l’existence en acte). Il se produit alors, dans le texte de Descartes (et c’est là un des aspects les plus frappants de son originalité) comme une dynamisation, ou comme une fécondation interne : en même temps que la pensée dit « je pense, j’existe » ou « je suis, j’existe » elle pose qu’elle peut valablement réfléchir sur elle-même et sur sa propre nature. Elle découvre à la fois un critère général de la vérité et le fait que ce critère s’applique à elle-même dans l’exacte mesure où il n’est rien d’autre qu’elle-même. En effet : penser, c’est être, et cette pensée dit à la fois la nature de l’être (et de la pensée) et la véracité de cet acte qui se saisit donc à bon droit comme pensée et comme existence.
Tout se passe donc comme si Descartes mettait en œuvre, pour la première fois, cette vérité que la phénoménologie de Husserl exprimera clairement et rapportera en effet à Descartes : le suiet est fondement de vérité parce qu’il exprime, par sa propre structure réflexive et connaissante, la proximité et même l’identité du sujet connaissant et de l’objet connu.
Cette identité n’est pas clairement formulée par Descartes, mais c’est bien elle que sa description met en œuvre.
Le Cogito est en effet non seulement critère mais commencement. L’appréhension de la pensée par elle-même, en tant qu’elle est la certitude d’exister et d’exister comme pensée, devient le commencement du déploiement d’une doctrine de la pensée. Après le Cogito, la pensée de Descartes poursuit son mouvement et peut, en toute sécurité épistémologique, continuer l’étude du sujet par lui-même. Alors que le déclenchement de la recherche était l’incertitude gnoséologique, la découverte d’un critère de certitude s’est manifestée en même temps comme le début de la connaissance elle-même. La recherche et la découverte d’une méthode (c’est-à-dire d’un critère et de ses préceptes d’application) se sont déployées elles-mêmes, sur la base de leur propre activité, comme la mise en place d’un commencement de connaissance et d’un début de doctrine. La recherche et la découverte d’un commencement pour une future connaissance se sont enrichies et transmutées elles-mêmes en commencement effectif de la connaissance. Écoutons Descartes :
« Je fermerai maintenant les yeux […] je détournerai tous mes sens, j’effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles […]; et ainsi m’entretenant seulement moi-même, et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c’est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui hait, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. »
Si le dessein cartésien ne s’est pas étendu « plus avant que […] de bâtir dans un fonds qui est tout à moi », il s’avère maintenant que ce « fonds » est le moi lui-même et que la construction consiste à organiser rationnellement la connaissance de ce qu’est le fondement lui-même : la doctrine cartésienne se déploiera comme la connaissance de ce « moi-même ».
Ainsi la méthode rend possible la doctrine, et le principe de l’évidence permet de délimiter, de définir et de réaliser les tâches de la connaissance. Cette unité de la méthode et de la doctrine s’accomplit dans la pensée réflexive. Plus précisément, l’évidence intuitive du Je (ou Cogito : je pense) se fonde elle-même comme condition de possibilité d’une connaissance de ce même Je par lui-même. Le cartésianisme, comme doctrine fondatrice de la modernité qui émergera de nouveau avec Kierkegaard et Husserl, consiste à définir simultanément un fondement pour la connaissance et un objet pour cette connaissance, celle-ci se révélant comme la description réflexive de cette pensée qu’elle est elle-même en tant qu’elle connaît : la philosophie a donc pour principe et pour commencement la réflexion, et, plus précisément, la connaissance réflexive de la réflexion.
Comment s’opère maintenant cette réflexion ? Elle est, en termes cartésiens, la connaissance de la « pensée » par elle-même.
Précisons la signification et la portée de cette doctrine fondatrice. Arrivé jusqu’au « fond » qui permettra un nouveau départ (comme pour le nageur), le philosophe découvre que ce fond (qui se dynamisera comme fondement, c’est-à-dire condition de possibilité de la connaissance et déploiement de celle-ci) est la pensée elle-même. Les termes de réflexion ou connaissance réflexive ne sont pas prononcés. Mais le sens des descriptions cartésienne est bien celui-ci : la philosophie est le déploiement d’une connaissance en première personne (Descartes dit : Je, indiquant un universel concret), l’objet de cette connaissance étant le moi « lui-même » s’efforçant de se rendre plus « familier à moi-même » et n’ayant affaire qu’à son « intérieur ».
Ni le terme de réflexion, ni le terme de sujet ne sont donc prononcés; mais la tâche et l’objet sont clairement définis : pour construire une philosophie (et, ensuite, une science) il faut d’abord qu’une âme singulière se découvre comme un Je personnel, et que ce Je s’assigne la tâche de connaître par ses seules ressources ce moi qu’il est. Le « Je » est un « moi » qui peut et doit se connaître « lui-même » puisqu’il est tout entier défini comme « pensée ».
Ce qui est alors remarquable (et fortement souligné par Husserl) c’est que la connaissance du moi est désormais spécifique et autonome.
Ayant récusé les opinions (c’est-à-dire explicitement la scolastique, l’astrologie, l’alchimie et la magie), Descartes écarte ensuite de sa pensée, par une hypothèse méthodologique, toutes les images, les sensations et les données corporelles qui n’entrent pas nécessairement dans la définition de l’essence de l’âme, c’est-à-dire ici de la pensée en première personne : par cette variation imaginative des contenus de la pensée il isole l’essence de celle-ci et peut conclure qu’elle consiste exclusivement dans cette pensée même. La conséquence est considérable : en se proposant seulement de montrer l’indépendance de l’âme par rapport au corps, Descartes découvre ou rend possible la découverte de la nouvelle méthode et du nouvel objet de la philosophie : il s’agit pour celle-ci de décrire de l’intérieur, lentement (sans « précipitation ») et d’une manière rationnelle (selon un ordre et enchaînement rigoureux), avec les seuls moyens de la connaissance intérieure de la pensée par elle-même, cette pensée précisément.
Sur ce chemin, l’observation interne livre de nombreuses connaissance qui constitueront ce que nous pourrions déjà désigner comme « la sphère de l’Ego » pour parler comme Husserl, mais qui se présentent plus exactement comme les aptitudes de la pensée, aptitudes qui sont en même temps son « essence », c’est-à-dire son être, sa nature et sa définition.
Quel est cet être ? Descartes le dit clairement, dans une énumération apparemment confuse et littéraire, mais en réalité totalisatrice et programmatique. Je suis une chose qui pense, « c’est-à-dire » qui doute, affirme et nie : un pouvoir de connaître est ainsi défini. Cette pensée est aussi l’acte d’aimer, de haïr, de vouloir, d’imaginer et de sentir : une affectivité, une sensibilité, un pouvoir de décision, sont à leur tour définis, et considérés comme parties intégrantes et essentielles de « la pensée ».
Ainsi, contrairement à la vision strictement intellectualiste qu’on a pu donner du « Cogito » (comme on dit), l’âme n’est pas un simple pouvoir de connaître, le Je n’est pas un sujet abstrait dont la seule fonction serait de connaître le monde (comme plus tard chez Kant). Bien au contraire, la pensée est tout entière activité de penser et conscience de soi, et cette activité, cette conscience sont aussi bien gnoséologiques (connaissance) qu’affectives (amour, haine), aussi bien sensibles (sensations, perceptions) que volitives (affirmation, négation, vouloir). En termes plus ramassés nous pourrions dire que le domaine de la pensée est tout entier une conscience en première personne, et qu’il englobe tous les aspects de la vie du moi.
C’est donc bien « un champ Egologique » que Descartes a mis en place, et ce champ est une activité polyvalente déployée en première personne par un Ego qui est une pensée, c’est-à-dire aussi bien une connaissance de soi et du monde, qu’un moi intérieur et concret.
C’est précisément cette richesse du Cogito cartésien qui, au-delà de la fécondité indéfinie de l’affirmation du Je comme fondement de la vérité et premier objet de la connaissance, va entraîner d’insurmontables difficultés dues à l’intention métaphysique du cartésianisme.
2 Les difficultés doctrinales du dualisme cartesien
On se souvient de l’intention explicite des Méditations : il s’agit pour Descartes de démontrer l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme. C’est ce double projet qui va hypothéquer la validité même, c’est-à-dire la « vérité » des contenus développés progressivement à partir du Cogito.
2.1. Dieu et la vérité : le cercle
La première difficulté réside dans la doctrine même de la vérité, doctrine qui « enveloppe » et implique un grave cercle logique. Alors que, au commencement de la réflexion cartésienne, le critère de la vérité repose sur la seule évidence intérieure et sur l’exigence autonome que les idées soient assez claires et distinctes pour entraîner une intuition intellectuelle d’évidence, la suite de cette réflexion s’appuie sur Dieu.
Comme l’affirment la « Quatrième » et la « Cinquième Méditation », les connaissances évidentes resteraient ponctuelles, momentanées, et pourraient se transformer en opinions fragiles s’il n’existait pas un Dieu qui puisse garantir la vérité de ces connaissances. C’est donc finalement sur Dieu et sur le fait qu’il est parfait et donc non trompeur que repose la vérité. Celle-ci dépend donc de la « véracité » divine et non plus de l’évidence du Cogito.
Ce glissement dans l’ordre des idées devient franchement un cercle ou une pétition de principe si l’on s’avise que l’existence de Dieu fut démontrée grâce au principe d’évidence, puisque toutes les preuves de son existence (par l’idée de perfection ou par la « preuve ontologique ») reposent sur l’évidence intellectuelle des enchaînements logiques mis en œuvre dans ces démonstrations. Ainsi : le Cogito permet de démontrer Dieu, mais c’est Dieu qui garantit la vérité du Cogito.
2.2. La connaissance de l’âme : le chosisme
Apparemment garantie par une métaphysique de la transcendance, la connaissance de l’âme va se déployer selon des voies traditionnelles et s’affranchir plus ou moins de la règle de l’évidence.
C’est ainsi, qu’après la découverte du « Cogito », Descartes s’interroge : « mais moi, qui suis-je… ? » et répond selon un style de pensée induit par la tradition. En effet, dans le Discours, il est « une substance » dont toute l’essence est de penser (4° Partie) ; dans les Méditations, il est « une chose qui pense (« Méditations Seconde et Troisième »).
Nous serions en présence d’une simple formulation approximative et provisoire si la suite des Méditations n’opposait pas radicalement l’âme et le corps, et cela afin de sauver l’immortalité de celle-ci. Mais dès lors qu’un dualisme substantialiste résulte de la première formulation, celle-ci s’avère une véritable prise de position doctrinale : l’âme est une chose. Elle est à ce titre sous-jacente aux qualités secondes, elle est une substance au sens strict, et cette substance n’est pas définie comme un acte, elle est posée comme une réalité indépendante et inerte.
Il y a là en fait une ambiguïté ou une incertitude. Car l’essence de cette chose indépendante du corps est semble-t-il, de penser, c’est-à-dire d’effectuer les actes énumérés plus haut (aimer, haïr, vouloir, douter, etc.). Mais, l’ambiguité tourne au profit de la choseité lorsque ces actes sont attribués à deux facultés, l’entendement et la volonté, qui sont exercées par la substance âme : celle-ci est alors une chose qui a le pouvoir de juger et de vouloir, mais elle reste une chose capable de vivre indépendamment du corps. C’est que celui-ci est aussi une chose : une « substance étendue », obéissant aux lois de la géométrie et de la mécanique.
Le chosisme substantialiste, destiné à sauver l’immortalité de l’âme, entraîne alors la doctrine dans de nouvelles difficultés, celles du dualisme.
2.3. L’âme et le corps : l’incompatibilité dualiste
Si l’âme est une « substance pensante » et si le corps est une « substance étendue », la relation de ces deux réalités distinctes qui constituent l’individu humain devient incompréhensible. Et c’est bien là le sort de toute théorie de l’âme : elle rend impossible ou mystérieux le rapport de l’âme et du corps.
Mais ce rapport est aussi essentiel que la distinction respective des substances lorsqu’elles sont posées comme autonomes. Aussi Descartes est-il conduit à utiliser les moyens du bord pour rendre compte de cette union de l’âme et du corps : c’est la doctrine des « esprits animaux », issue de la physique animiste de la Renaissance.
Ce sont des « vapeurs subtiles » qui circulent non plus dans le sang mais dans les nerfs, et qui se font le véhicule des impulsions venues du dehors et conduites vers l’âme et ainsi commandées aux esprits pour qu’ils meuvent les muscles. L’organe central de ce double mouvement des esprits est la « glande pinéale » (épiphyse): elle est le lieu d’ancrage de l’âme dans le corps, et l’organe de direction du corps par l’âme : celle-ci agit d’abord sur la glande pinéale et ses orientations, et ce sont les mouvements de cette glande qui commandent les mouvements du corps.
La solution, qui semble mécaniste, est en réalité animiste, et ne fait que déplacer un problème insoluble : comment une âme immatérielle peut-elle agir sur une vapeur subtile matérielle, ou même sur un organe matériel, telle une glande ?
Certes, la nouvelle approche mécaniste du corps et de ses mouvements souhaitait instaurer une rationalité scientifique à la place d’une vision magique et animiste des puissances du corps. Mais ce mécanisme lui-même est en contradiction avec la nature spirituelle de l’âme : le XVIIe siècle se libère de l’occultisme de la Renaissance, mais en choisissant des solutions extrêmes inspirées par une métaphysique chrétienne spiritualiste : d’un côté (« en haut ») se trouve l’âme, substance simple et pure pen-sée, – et de l’autre (« en bas ») se trouve le corps, substance composée et inerte.
L’opposition dualiste de cette âme et de ce corps est si forte, et si contraire à l’expérience vécue, que Descartes a dû inventer une troisième substance, l’homme lui-même : mais il s’agit de quelques remarques dans une lettre.
Le dualisme cartésien n’en est pas dépassé ni allégé et c’est à cet immense problème de l’unité organique entre le corps et l’esprit que s’efforceront de répondre Spinoza dès le XVIIe siècle, et la phénoménologie, à l’aube du XXe siècle avec, notamment, Maurice Merleau-Ponty.
2.4. L’entendement et la volonté : l’abstraction d’une âme sans Désir
Le dualisme de l’âme et du corps réitère, chez Descartes, le dualisme qui opposait Dieu, substance spirituelle, et le monde, substance matérielle. Il se redouble en aval sous la forme d’un nouveau dualisme : celui qui oppose les deux facultés de l’âme, l’entendement et la volonté.
Les descriptions de la volonté sont certes admirables. La faculté de vouloir réside d’abord essentiellement dans le pouvoir d’affirmer ou de nier et ce pouvoir est en l’homme infini, c’est-à-dire total et absolu, semblable à celui-là même de Dieu (dit Descartes). On peut entendre ici un écho, ou une prise de conscience réflexive de la radicalité de l’affirmation de la liberté par La Boétie. On peut également lire ici une belle anticipation des théories contemporaines de la responsabilité (comme celle de Sartre, par exemple), où celle-ci est infinie, comme est infini chez Descartes le pouvoir d’accepter ou de refuser un jugement, une connaissance proposés par l’entendement et toujours susceptibles d’être récusés ou admis par notre libre vouloir.
Mais cet élan et cet amour de la liberté, constitutifs désormais de la civilisation européenne, ne peuvent suffire à constituer valablement une doctrine du sujet libre.
En effet, la faculté de vouloir chez Descartes, reste abstraite: elle est sans contenu, sans motivation et, pour le dire d’un terme, sans Désir. Elle est la pure liberté d’indifférence, le pur « libre arbitre » capable de se déterminer (sans autre raison que le vouloir lui-même) à prendre une décision ou la décision contraire, un chemin ou son opposé. L’âme libre est alors comme suspendue. Fondement ultime de toutes les décisions, le libre arbitre reste en droit objectif, vide et « indifférent ». Descartes reconnaît certes que c’est là « le plus bas degré de la liberté » et souhaite que l’entendement fournisse à la liberté la « connaissance du bien » et, par conséquent, les raisons d’agir. Ce n’est que mieux souligner le caractère abstrait d’une liberté subjective qui ne serait rien d’autre que le pouvoir de nier ou d’affirmer. Cette liberté, plus que celle d’un « sujet » serait « subjective », abstraite et désincarnée.
La seule affirmation cartésienne que nous retiendrons ici comme décisive, est l’évocation explicite du sujet : le terme est simplement prononcé, mais sa fécondité philosophique sera indefinie et fondatrice lointaine de notre modernité : « …pour commencer, je considère que tout ce qui se fait et qui arrive de nouveau est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de celui qui fait qu’il arrive… » (Traité des passions, Art. 1. ; ).
Robert Misrahi – « Les figures du moi et la question du sujet depuis la renaissance. »